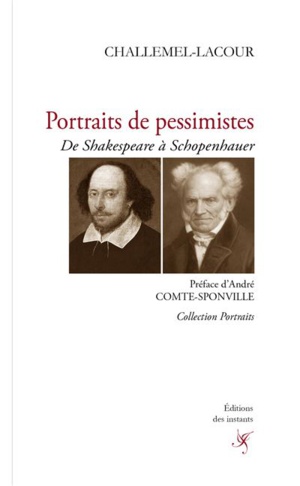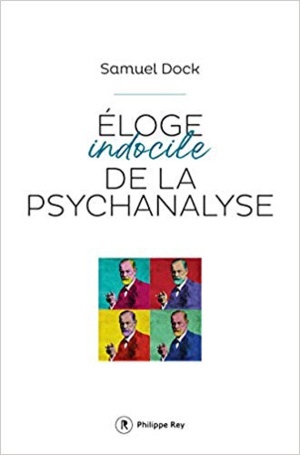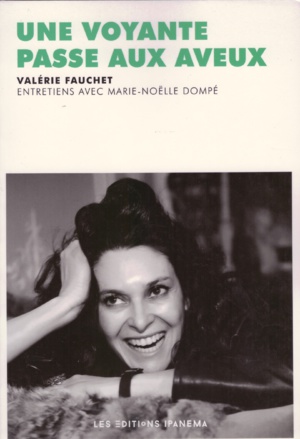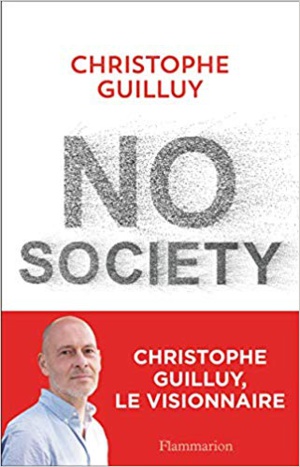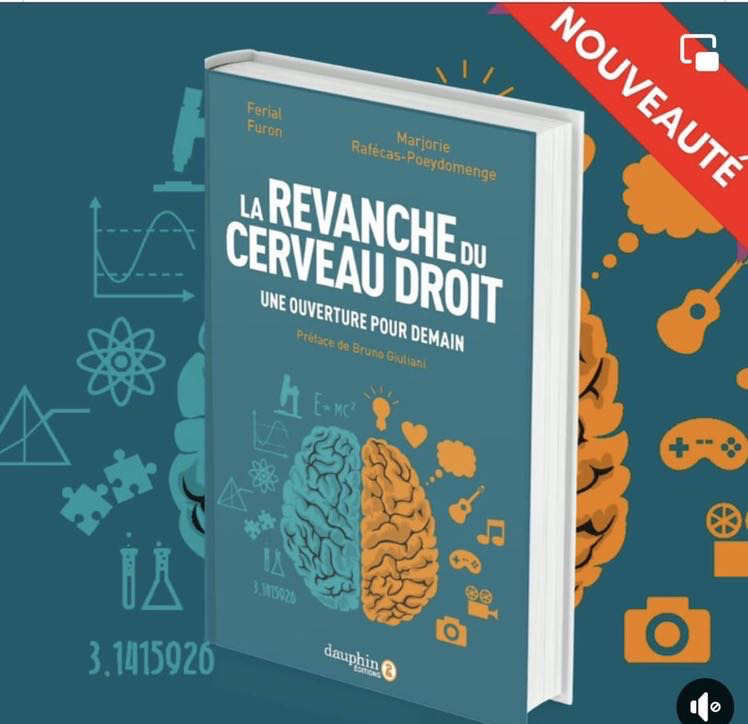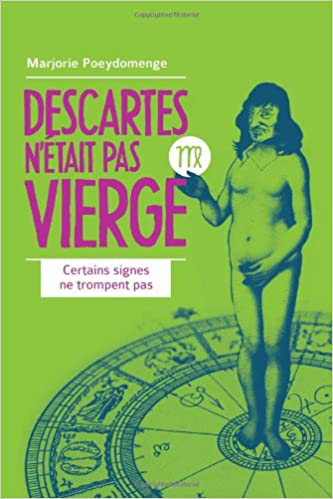II faut choisir : ça dure ou ça brûle ; le drame, c'est que ça ne puisse pas à la fois durer et brûler. Albert Camus
 LIVRES PHILous
LIVRES PHILous
Dimanche 8 Mars 2026
Puisque la punchline de mon blog s’intitule l’anti burn-out des idées, comment ne pas évoquer le « Petit traité des idées à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre » de François Belley (Guy Trédaniel éditeur). Cet ouvrage s’appelle « Petit traité », mais il a plutôt le punch d’un manifeste en 50 recommandations, la vigueur des lettres capitales et des points d’exclamation, un côté clairement punk, avec l’instinct d’un pirate pour vous réveiller de votre hibernation, si jamais vous êtes encore engourdis... Je le rapprocherais plutôt d’une ode à la confiance en soi d’Emerson : OSEZ ! Doublée par l’esprit ironique d’Oscar Wilde : Osez, car les autres sont déjà pris !

A l’époque de l’Antiquité et de Platon (encore lui, oui, ses idées sont invincibles !), les idées étaient soufflées par les divinités. Mais les muses de l’inspiration ne sont pas toujours au rendez-vous, le déclic est souvent capricieux. Le mot « idée » est sexy et sonne comme une déesse. Cependant, « l’enjeu consiste à passer de l’eidos chère à Platon à l’idea, c’est-à-dire d’une forme abstraite à un aspect concret ».
La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que les dieux viennent vous souffler une idée géniale, les idées germent en fait partout ! Il suffit de bouger pour les capter. La lutte contre la routine est la première révolution pour entrer dans le monde des idées.
« Les idées viennent de tout », écrivait Hitchcock.
« L’artiste est un entonnoir » et doit se positionner à l’intersection des mondes.
Les nouvelles idées peuvent naître d’idées détournées, d’incongrues associations, il est conseillé de jouer, s’amuser… Point de mal à devenir graphomaniaque, à la façon de David Lynch qui écrivait sur des boîtes d’allumettes.
La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que les dieux viennent vous souffler une idée géniale, les idées germent en fait partout ! Il suffit de bouger pour les capter. La lutte contre la routine est la première révolution pour entrer dans le monde des idées.
« Les idées viennent de tout », écrivait Hitchcock.
« L’artiste est un entonnoir » et doit se positionner à l’intersection des mondes.
Les nouvelles idées peuvent naître d’idées détournées, d’incongrues associations, il est conseillé de jouer, s’amuser… Point de mal à devenir graphomaniaque, à la façon de David Lynch qui écrivait sur des boîtes d’allumettes.

Ne pas craindre de rentrer en collision
De la friction naît l’étincelle des idées. Il ne faut pas craindre de se frotter aux idées des autres. Il faut se « forcer » à devenir un agent provocateur. « L’époque est ainsi elle n’aime que les plats relevés ». C’est un peu l’art de la guerre ; lancer des hostilités comme des coups de foudre. C’est la partie du livre qui vous explique comment se faire entendre, car ce n’est pas tout d’avoir des idées et des supers pouvoirs dionysiaques «Eureka ». Encore faut-il savoir créer le buzz….
De la friction naît l’étincelle des idées. Il ne faut pas craindre de se frotter aux idées des autres. Il faut se « forcer » à devenir un agent provocateur. « L’époque est ainsi elle n’aime que les plats relevés ». C’est un peu l’art de la guerre ; lancer des hostilités comme des coups de foudre. C’est la partie du livre qui vous explique comment se faire entendre, car ce n’est pas tout d’avoir des idées et des supers pouvoirs dionysiaques «Eureka ». Encore faut-il savoir créer le buzz….
Être le premier comme André Breton et non le meilleur
Il est également recommandé de savoir tirer le premier, même si nous ne sommes pas complètement sûrs de la qualité d’une idée. Car la valeur d’une idée dépend de son utilisation. Il faut même oser se faire payer pour ses idées, pour prouver leur utilité.
Les consultants de BCG ou autres marques de conseil en stratégie devraient bénir Bergson d’avoir écrit « il y a, en effet, depuis des siècles, des hommes dont la fonction est de voir, de nous faire voir ce que nous n’apercevons pas naturellement » (la Pensée et le Mouvant). En temps mouvant, il est apprécié de penser vite et loin. Les leaders n’ont-ils pas l’avantage d’être visionnaire ?

Entendez tout le monde et n’écoutez personne
Pour avoir des idées, il est essentiel de savoir écouter derrière toute les portes, tout en n'écoutant personne. Là est le paradoxe ! Cherchez des lieux inspirants, des clusters créatifs, tout en restant dans votre tour d’ivoire, personne ne doit ni voler vos idées, ni les influencer. Seul vous, avez le droit de les capturer et les remodeler !
Le syndrome de l’imposteur est de donner un pouvoir incommensurable aux autres, oubliez cette posture…
Etre infidèle à ses idées
Une fois vos idées lancées, il n’est point nécessaire d’être loyal. Il est possible de « bonnardiser » ses œuvres. Les idées ne sont jamais totalement achevées. Pour cette raison, il faut savoir en créer sans cesse des nouvelles. Tout est dans la nuance dans la philosophie des pirates des idées !
Un côté assurément nietzschéen rugit dans cet essai.
Bertrand A. W. Russel y apporterait la nuance suivante : « La chose la plus difficile au monde n’est pas que les gens acceptent de nouvelles idées, mais qu’ils oublient les anciennes ».
Ainsi, une idée met du temps à se répandre, tant les réflexes de la routine et les biais cognitifs sont puissants. La 1ère édition de L'interprétation des rêves de Freud a été un vrai flop au départ. Ainsi, une idée révolutionnaire peut avoir besoin de temps pour infuser...
François Belley est producteur d’idées, et rien d’autre. Il est tour à tour publicitaire, essayiste, romancier, conférencier et concepteur de jeu de société.
Petit traité des idées à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre, François Belley, (Guy Trédaniel éditeur, 2025).
Pour avoir des idées, il est essentiel de savoir écouter derrière toute les portes, tout en n'écoutant personne. Là est le paradoxe ! Cherchez des lieux inspirants, des clusters créatifs, tout en restant dans votre tour d’ivoire, personne ne doit ni voler vos idées, ni les influencer. Seul vous, avez le droit de les capturer et les remodeler !
Le syndrome de l’imposteur est de donner un pouvoir incommensurable aux autres, oubliez cette posture…
Etre infidèle à ses idées
Une fois vos idées lancées, il n’est point nécessaire d’être loyal. Il est possible de « bonnardiser » ses œuvres. Les idées ne sont jamais totalement achevées. Pour cette raison, il faut savoir en créer sans cesse des nouvelles. Tout est dans la nuance dans la philosophie des pirates des idées !
Un côté assurément nietzschéen rugit dans cet essai.
Bertrand A. W. Russel y apporterait la nuance suivante : « La chose la plus difficile au monde n’est pas que les gens acceptent de nouvelles idées, mais qu’ils oublient les anciennes ».
Ainsi, une idée met du temps à se répandre, tant les réflexes de la routine et les biais cognitifs sont puissants. La 1ère édition de L'interprétation des rêves de Freud a été un vrai flop au départ. Ainsi, une idée révolutionnaire peut avoir besoin de temps pour infuser...
François Belley est producteur d’idées, et rien d’autre. Il est tour à tour publicitaire, essayiste, romancier, conférencier et concepteur de jeu de société.
Petit traité des idées à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre, François Belley, (Guy Trédaniel éditeur, 2025).
Rédigé par Marjorie Rafécas le Dimanche 8 Mars 2026 à 16:18
|
Commentaires (0)
Jongler avec le temps sporadique du mois de mai avec ses jours fériés et ponts, comme des soupirs et soubresauts, pour enfin s'interroger sur son propre tempo... Le mois de mai n'est-il pas le moment idéal pour se poser et s'éloigner de l'impératif catégorique des rythmes collectifs pour réinventer ou retrouver son propre tempo. Voici un livre qui pourrait vous aider : "A chacun son rythme, petite philosophie du tempo à soi", d'Aliocha Wald Lasowski. A lire en musique bien sûr !

Face à l’impératif catégorique des algorithmes et des cadences infernales de la société moderne, créer son propre rythme, son « allorythme », pour reprendre les mots d’Aliocha Wald Lasowski est aujourd’hui plus que nécessaire : c’est vital. Oui, l’individu doit mettre en place des contre-rythmes, pour résister au sentiment d’absurdité si bien décrit par Albert Camus.
Cet essai prolixe et original met en évidence la place du rythme dans nos vies, qui va de notre rapport aux autres, à la nature et même à l’univers. Il mêle à la fois des théories philosophiques, scientifiques, économiques, artistiques, musicales, le tout avec poésie. Le rhuthmos au sens platonicien permet de penser la place de l’être humain dans le cosmos. Le rythme n’est pas anodin, il est question de notre rapport au monde et de l’harmonie que l’on cocrée avec la symphonie du monde. Dans le rythme, nous avons à la fois de la poésie et de la philosophie, une façon de réfléchir et sentir notre « logos poétique ». Le poète lyrique, Archiloque, emploie le mot rythme (rythmos) pour le relier à la recherche d’un équilibre moral et physique.
L’enjeu du rythme est ainsi un impératif humain : se réconcilier avec soi et l’univers.
L’enfer, c’est les rythmes
Depuis la révolution industrielle, le rapport au temps dysfonctionne, il en va de même avec le rapport au monde. Contrairement aux apparences, le numérique nous aliène. Tous les matins, en plus de notre traditionnel café ou thé, s’est institué peu à peu le rituel du petit déjeuner digital. Les chiffres témoignent de cette addiction : 40 % des moins de 18 ans ne peuvent pas se séparer de leur smartphone plus de cinq minutes. L’auteur nous invite à créer un rythme-relation pour confronter son rythme avec celui des autres. Car l’enfer, c’est les rythmes (et surtout le rythme des autres, pour reprendre la formule de Sartre). Or vivre, c’est de préférence avancer à son rythme et créer son rythme en avançant. Pour cadencer son propre rythme, rien de tel que de cultiver sa curiosité. « Il y a plus d’avenir dans l’instable que dans le stable. » (Robert Musil). Mais, il faut aussi prendre conscience que nous sommes traversés par le rythme monde, des mémoires plurielles… Donc l’enfer n’est pas nécessairement les autres…
Nietzsche, le premier philosophe à proposer deux rythmes opposés
Nietzsche, sensible aux rythmes-monde, écrit La vision dionysiaque du monde, deux ans auparavant La naissance de la tragédie. Ce bref récit expose l’affrontement entre deux forces esthétiques opposées du monde hellénistique : celle du temps harmonieux, ordonné et mesuré de la « sagesse délimitée » incarnée par le dieu Apollon, sculpteur, avec celle de la cadence frénétique de satyres, comme Silène, de Dionysos. Nietzsche explique comment on a pu basculer du rythme plastique au rythme chaotique. Ces deux rythmes sont essentiels pour comprendre la métaphysique rythmique de nos désirs, mais aussi nos tiraillements quotidiens.
Se ressourcer dans le rythme de la nature
Dans Mille Plateaux de Deleuze et Guattari, il existe une continuité entre l’esthétique et le monde naturel. En effet, le premier musicien de la création, c’est l’oiseau ! Même l’âme humaine est rythmique, étant reliée aux battements du cœur. Le rythme c’est aussi celui de notre rythme cardiaque. L’énergie circulatoire était essentielle pour les médecins philosophes. Le rythme physique est une énergie psychique. N’oublions pas également que le féminisme a modifié le rythme biologique des femmes : la contraception a permis aux femmes de se réapproprier un nouveau rythme. Et trouver son rythme, c’est trouver sa place.
Ce rythme de la nature est mis en valeur dans de nombreux ouvrages philosophiques et poétiques. Gaston Bachelard se plaît à évoquer le flux musical des pierres, la mélodie rocailleuse d’une grammaire minérale. « La mémoire du monde est enfouie dans la matérialité des pierres ». Il y a un certain mystère dans le rythme de la nature, la marque de l’insondable. La calligraphie chinoise tente d’exprimer ce mystère, en représentant les qualités vibratoires et énergétiques du monde, le souffle du vivant.
Se créer un temps flottant
A la manière de Proust, il est délicat de savoir déguster « un peu de temps à l’état pur ». Dans sa conception de la musique, le philosophe Gilles Deleuze propose une « cartographie des variables, soit une approche concrète des enjeux du rythme musical ». Il exprime l’idée d’un temps « non pulsé ». Le « temps non pulsé » est un temps libéré de la mesure, qui échappe à la pulsation classique. L’idée principale de Deleuze est forte : la musique est capable de créer des temps hétérogènes. Cette variabilité du temps non pulsé s’illustre dans le concerto pour piano, en fa majeur de Georges Gershwin. Cela revient au « temps flottant » de Proust.
Ces temps flottants permettent d’améliorer la créativité entre les rythme-relations avec les autres et l’inter-rythme à l’intérieur de soi. Ce « va et vient » rythmique est essentiel pour tenter de se réinventer. Walter Benjamin évoque d’ailleurs la rythmique de la pensée faite de coups et contre-coups. Mais jusqu’où se dérégler ? Les pratiques de déphasage et de variation sont-elles sans risque ? Seul Dionysos le sait…
En attendant, laissons-nous charmer par les rythmes spirituels de la nature, de l’art et de la vie. Tout en prenant garde à [ la « Dromocratie », qui signifie que le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent la vitesse…
A chacun son rythme, petite philosophie du tempo à soi, 2023, 237 pages, 20 €, Aliocha Wald Lasowski, Editions Le Pommier
A propos de l’auteur
Musicien et philosophe, Aliocha Wald Lasowski est l’auteur de vingt-cinq livres. Enseignant chercheur à l’université, il est aussi batteur de pop, de rythm’n’blues et de soul music.
Cet essai prolixe et original met en évidence la place du rythme dans nos vies, qui va de notre rapport aux autres, à la nature et même à l’univers. Il mêle à la fois des théories philosophiques, scientifiques, économiques, artistiques, musicales, le tout avec poésie. Le rhuthmos au sens platonicien permet de penser la place de l’être humain dans le cosmos. Le rythme n’est pas anodin, il est question de notre rapport au monde et de l’harmonie que l’on cocrée avec la symphonie du monde. Dans le rythme, nous avons à la fois de la poésie et de la philosophie, une façon de réfléchir et sentir notre « logos poétique ». Le poète lyrique, Archiloque, emploie le mot rythme (rythmos) pour le relier à la recherche d’un équilibre moral et physique.
L’enjeu du rythme est ainsi un impératif humain : se réconcilier avec soi et l’univers.
L’enfer, c’est les rythmes
Depuis la révolution industrielle, le rapport au temps dysfonctionne, il en va de même avec le rapport au monde. Contrairement aux apparences, le numérique nous aliène. Tous les matins, en plus de notre traditionnel café ou thé, s’est institué peu à peu le rituel du petit déjeuner digital. Les chiffres témoignent de cette addiction : 40 % des moins de 18 ans ne peuvent pas se séparer de leur smartphone plus de cinq minutes. L’auteur nous invite à créer un rythme-relation pour confronter son rythme avec celui des autres. Car l’enfer, c’est les rythmes (et surtout le rythme des autres, pour reprendre la formule de Sartre). Or vivre, c’est de préférence avancer à son rythme et créer son rythme en avançant. Pour cadencer son propre rythme, rien de tel que de cultiver sa curiosité. « Il y a plus d’avenir dans l’instable que dans le stable. » (Robert Musil). Mais, il faut aussi prendre conscience que nous sommes traversés par le rythme monde, des mémoires plurielles… Donc l’enfer n’est pas nécessairement les autres…
Nietzsche, le premier philosophe à proposer deux rythmes opposés
Nietzsche, sensible aux rythmes-monde, écrit La vision dionysiaque du monde, deux ans auparavant La naissance de la tragédie. Ce bref récit expose l’affrontement entre deux forces esthétiques opposées du monde hellénistique : celle du temps harmonieux, ordonné et mesuré de la « sagesse délimitée » incarnée par le dieu Apollon, sculpteur, avec celle de la cadence frénétique de satyres, comme Silène, de Dionysos. Nietzsche explique comment on a pu basculer du rythme plastique au rythme chaotique. Ces deux rythmes sont essentiels pour comprendre la métaphysique rythmique de nos désirs, mais aussi nos tiraillements quotidiens.
Se ressourcer dans le rythme de la nature
Dans Mille Plateaux de Deleuze et Guattari, il existe une continuité entre l’esthétique et le monde naturel. En effet, le premier musicien de la création, c’est l’oiseau ! Même l’âme humaine est rythmique, étant reliée aux battements du cœur. Le rythme c’est aussi celui de notre rythme cardiaque. L’énergie circulatoire était essentielle pour les médecins philosophes. Le rythme physique est une énergie psychique. N’oublions pas également que le féminisme a modifié le rythme biologique des femmes : la contraception a permis aux femmes de se réapproprier un nouveau rythme. Et trouver son rythme, c’est trouver sa place.
Ce rythme de la nature est mis en valeur dans de nombreux ouvrages philosophiques et poétiques. Gaston Bachelard se plaît à évoquer le flux musical des pierres, la mélodie rocailleuse d’une grammaire minérale. « La mémoire du monde est enfouie dans la matérialité des pierres ». Il y a un certain mystère dans le rythme de la nature, la marque de l’insondable. La calligraphie chinoise tente d’exprimer ce mystère, en représentant les qualités vibratoires et énergétiques du monde, le souffle du vivant.
Se créer un temps flottant
A la manière de Proust, il est délicat de savoir déguster « un peu de temps à l’état pur ». Dans sa conception de la musique, le philosophe Gilles Deleuze propose une « cartographie des variables, soit une approche concrète des enjeux du rythme musical ». Il exprime l’idée d’un temps « non pulsé ». Le « temps non pulsé » est un temps libéré de la mesure, qui échappe à la pulsation classique. L’idée principale de Deleuze est forte : la musique est capable de créer des temps hétérogènes. Cette variabilité du temps non pulsé s’illustre dans le concerto pour piano, en fa majeur de Georges Gershwin. Cela revient au « temps flottant » de Proust.
Ces temps flottants permettent d’améliorer la créativité entre les rythme-relations avec les autres et l’inter-rythme à l’intérieur de soi. Ce « va et vient » rythmique est essentiel pour tenter de se réinventer. Walter Benjamin évoque d’ailleurs la rythmique de la pensée faite de coups et contre-coups. Mais jusqu’où se dérégler ? Les pratiques de déphasage et de variation sont-elles sans risque ? Seul Dionysos le sait…
En attendant, laissons-nous charmer par les rythmes spirituels de la nature, de l’art et de la vie. Tout en prenant garde à [ la « Dromocratie », qui signifie que le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent la vitesse…
A chacun son rythme, petite philosophie du tempo à soi, 2023, 237 pages, 20 €, Aliocha Wald Lasowski, Editions Le Pommier
A propos de l’auteur
Musicien et philosophe, Aliocha Wald Lasowski est l’auteur de vingt-cinq livres. Enseignant chercheur à l’université, il est aussi batteur de pop, de rythm’n’blues et de soul music.
Jean-Christophe Grellety, qui a accompagné le philosophe Marc Sautet dans l'aventure des cafés-philo, tire un bilan de cette époque rebelle dans son livre "Cafés-Philo en France, un malentendu & un échec", publié en 2023. La mode des « cafés-philo » serait-elle née d’un idéalisme platonicien cultivé par de jeunes esprits à cheveux longs fatigués du dogmatisme universitaire ? Jean-Christophe Grellety a appartenu à cette trempe chevelue et indocile aux côtés de Marc Sautet, auteur d’Un Café pour Socrate et l’instigateur du premier « café philosophique » en France.
Jean-Christophe Grellety témoigne brièvement également de son expérience dans la presse : le magazine Socrate&co, l'actualité vue par les philosophes qu'il avait créé en 1996. Car le débat ne doit-il pas aussi une prise de recul face à l'actualité mitraillette et envahissante ?

Cafés-philo en France, un malentendu un échec JC Grellety
Jean-Christophe Grellety est resté fidèle à cet engagement civique de Marc Sautet (hélas décédé en 1998), qu’il n’hésitait pas parfois à contredire et à titiller… Telle est la vertu du dialogue. Il continue à croire envers (en verve) et contre tout, à la puissance de la dialectique, et c’est pourquoi il persiste et signe par un nouvel essai (1) qui pourrait s’apparenter à un pamphlet contre la pensée moutonnière et paresseuse.
Dans ce livre, l’auteur, professeur de philosophie, s’interroge sur le réel retentissement qu’ont pu avoir les cafés philosophiques, dont il tire une sorte de bilan plutôt mitigé. Les cafés-philo ont-ils vraiment réussi à nous sortir de la caverne ? Le dialogue suffit-il à ne plus être prisonnier de ses impressions ? Un café pour Socrate de Marc Sautet avait pour objectif de lancer et soutenir les cafés philo en référence explicite à une pensée philosophique originale pour permettre à des pauvres citoyens pris dans le labyrinthe du Minotaure de s’en sortir.
Comme Jacques Derrida l’a rappelé dans un célèbre texte, la parole est pharmakon, à la fois substance active, médicament ou poison selon son usage…
Dans ce livre, l’auteur, professeur de philosophie, s’interroge sur le réel retentissement qu’ont pu avoir les cafés philosophiques, dont il tire une sorte de bilan plutôt mitigé. Les cafés-philo ont-ils vraiment réussi à nous sortir de la caverne ? Le dialogue suffit-il à ne plus être prisonnier de ses impressions ? Un café pour Socrate de Marc Sautet avait pour objectif de lancer et soutenir les cafés philo en référence explicite à une pensée philosophique originale pour permettre à des pauvres citoyens pris dans le labyrinthe du Minotaure de s’en sortir.
Comme Jacques Derrida l’a rappelé dans un célèbre texte, la parole est pharmakon, à la fois substance active, médicament ou poison selon son usage…

Un café pour Socrate, Marc Sautet
En finir avec un Socrate trop éthérique et idéalisé
L’auteur dénonce un enseignement philosophique trop abstrait. Socrate y est démesurément idéalisé et limité à une iconographie hagiographique qui le dessert. Le monde de Platon en est ainsi transformé, comme s’il était éthérique, abstrait, il en est réduit à un monde des idées. Il est important de remettre Socrate dans le contexte historique de son époque. Les recherches historiques, les découvertes archéologiques nous permettent de mieux appréhender Socrate, qui est un Athénien, devenu citoyen grâce aux réformes de Solon. Athènes, à cette époque, est une communauté divisée. Socrate a connu la guerre, les combats militaires. Il s’est rendu deux fois en expédition punitive à Potidée. Les Athéniens s’enrichissent par les guerres, le pillage, par le commerce des trésors volés… Dans l’Odyssée, on sent un Ulysse coupable et tourmenté d’avoir livré Troie à des Achéens ethnocidaires. Socrate pose les bonnes questions pour tenter de déjouer le cheval de Troie intérieur et comprendre les talons d’Achille des Athéniens. Selon l’auteur, il est fréquent de rencontrer des professionnels de la philosophie qui n’ont pas lu les auteurs dans le détail du texte. Par exemple, il dénonce les propos de Karl Popper qui avait rangé Platon dans la catégorie du premier penseur totalitaire, un anachronisme et une caricature. Au contraire, il règne « un sens des mystères » omniprésent dans l’œuvre de Platon : tout n’est pas dit, il n’y a pas un système clos. « C’est à chacun de faire l’expérience de ». Le rationalisme veut tuer le mystère et réduire le monde à quelques équations ou syllogismes. Mais les humains cultivent le droit de se mettre à l’ombre, comme à l’heure du romantisme, « de retrouver les mystères pour le meilleur et pour le pire, une nouvelle vie ». Les mythes insistent sur le fait que le réel n’est pas seulement ce qui se montre à la perception, ce sont aussi les choses cachées « depuis la fondation du monde ».
L’auteur dénonce un enseignement philosophique trop abstrait. Socrate y est démesurément idéalisé et limité à une iconographie hagiographique qui le dessert. Le monde de Platon en est ainsi transformé, comme s’il était éthérique, abstrait, il en est réduit à un monde des idées. Il est important de remettre Socrate dans le contexte historique de son époque. Les recherches historiques, les découvertes archéologiques nous permettent de mieux appréhender Socrate, qui est un Athénien, devenu citoyen grâce aux réformes de Solon. Athènes, à cette époque, est une communauté divisée. Socrate a connu la guerre, les combats militaires. Il s’est rendu deux fois en expédition punitive à Potidée. Les Athéniens s’enrichissent par les guerres, le pillage, par le commerce des trésors volés… Dans l’Odyssée, on sent un Ulysse coupable et tourmenté d’avoir livré Troie à des Achéens ethnocidaires. Socrate pose les bonnes questions pour tenter de déjouer le cheval de Troie intérieur et comprendre les talons d’Achille des Athéniens. Selon l’auteur, il est fréquent de rencontrer des professionnels de la philosophie qui n’ont pas lu les auteurs dans le détail du texte. Par exemple, il dénonce les propos de Karl Popper qui avait rangé Platon dans la catégorie du premier penseur totalitaire, un anachronisme et une caricature. Au contraire, il règne « un sens des mystères » omniprésent dans l’œuvre de Platon : tout n’est pas dit, il n’y a pas un système clos. « C’est à chacun de faire l’expérience de ». Le rationalisme veut tuer le mystère et réduire le monde à quelques équations ou syllogismes. Mais les humains cultivent le droit de se mettre à l’ombre, comme à l’heure du romantisme, « de retrouver les mystères pour le meilleur et pour le pire, une nouvelle vie ». Les mythes insistent sur le fait que le réel n’est pas seulement ce qui se montre à la perception, ce sont aussi les choses cachées « depuis la fondation du monde ».

Jean-Christophe Grellety
Chaque dialogue est l’anti-tragédie même
Comme chacun sait, Socrate finit par être condamné à mort. L’ambivalence de la parole, son côté « pharmakon », a penché vers le poison. Athènes perd, selon Platon, et avec des arguments solides, le meilleur d’entre eux. Athènes ayant fait ce choix en dit long sur ce qu’elle est… Platon, fils d’Athènes, n’était pas résigné à accepter que la grande cité disparaisse. Chaque dialogue est l’anti-tragédie même et l’inverse de la mort, car l’échange propose une ouverture et un infini. A l’époque, les dialogues sont considérés comme des « ovnis », par contraste, avec « les tragédies hypnotiques par le bruit et la fureur ». Platon nous a légué tous ces dialogues, qui ont miraculeusement survécu à la disparition des mondes antiques, là où autant d’autres œuvres sont toujours introuvables. Ce miracle est-il lié à un mystère, le rayonnement du bien ? Qui a permis de sauver l’œuvre de Platon quand ceux d’Épicure ont tous disparu ? L’œuvre de Platon et Socrate ont survécu à la subversion du monde antique, « cette Atlantide disparue ».
L’enseignement de la philosophie participe aujourd’hui à ce dialogue qui est essentiel pour être dans le « noûs » grec qui veut dire intelligence.
Et les cafés-philo étaient une tentative de perpétuer ce « noûs », pour co-créer une intelligence collective. Et peut-être insuffler un élan de sagesse dans ce monde au rythme effréné. La bonne intention reste, l’auteur invite à la continuer, sans doute autrement.
(1) l’ouvrage propose deux textes différents, le premier concernant les cafés-philo, le second sur l’Education Nationale, l’enseignement de la Philosophie, l’humiliation des professeurs
Cafés-Philo en France, un malentendu & un échec, 2023, 180 pages, 21 €
Auteur : Jean-Christophe Grellety Editeur : BoD
Comme chacun sait, Socrate finit par être condamné à mort. L’ambivalence de la parole, son côté « pharmakon », a penché vers le poison. Athènes perd, selon Platon, et avec des arguments solides, le meilleur d’entre eux. Athènes ayant fait ce choix en dit long sur ce qu’elle est… Platon, fils d’Athènes, n’était pas résigné à accepter que la grande cité disparaisse. Chaque dialogue est l’anti-tragédie même et l’inverse de la mort, car l’échange propose une ouverture et un infini. A l’époque, les dialogues sont considérés comme des « ovnis », par contraste, avec « les tragédies hypnotiques par le bruit et la fureur ». Platon nous a légué tous ces dialogues, qui ont miraculeusement survécu à la disparition des mondes antiques, là où autant d’autres œuvres sont toujours introuvables. Ce miracle est-il lié à un mystère, le rayonnement du bien ? Qui a permis de sauver l’œuvre de Platon quand ceux d’Épicure ont tous disparu ? L’œuvre de Platon et Socrate ont survécu à la subversion du monde antique, « cette Atlantide disparue ».
L’enseignement de la philosophie participe aujourd’hui à ce dialogue qui est essentiel pour être dans le « noûs » grec qui veut dire intelligence.
Et les cafés-philo étaient une tentative de perpétuer ce « noûs », pour co-créer une intelligence collective. Et peut-être insuffler un élan de sagesse dans ce monde au rythme effréné. La bonne intention reste, l’auteur invite à la continuer, sans doute autrement.
(1) l’ouvrage propose deux textes différents, le premier concernant les cafés-philo, le second sur l’Education Nationale, l’enseignement de la Philosophie, l’humiliation des professeurs
Cafés-Philo en France, un malentendu & un échec, 2023, 180 pages, 21 €
Auteur : Jean-Christophe Grellety Editeur : BoD
Ps : j'en terminerai par un renvoi à un article de ce blog que j'avais déjà fait sur Socrate&co dans lequel Jean-Christophe Grellety m'avait donné l'opportunité d'écrire un article sur Schopenhauer : Schopenhauer la haine des femmes ou de sa mère, https://www.wmaker.net/philobalade/Schopenhauer-la-haine-des-femmes-ou-de-sa-mere_a7.htm://
Cet article est celui qui comptabilise le plus grand nombre de vues sur mon blog ! Donc merci Jean-Christophe !
Cet article est celui qui comptabilise le plus grand nombre de vues sur mon blog ! Donc merci Jean-Christophe !

 LIVRES PHILous
LIVRES PHILous
Dimanche 16 Janvier 2022
Alors que nous sommes encore en pleine crise sanitaire, que les médias stimulent sans cesse notre cerveau reptilien, la sagesse grecque, notamment celle des stoïciens, vient toquer à notre porte : si tu veux être heureux, commence déjà par relativiser le mot « bonheur », qui n’est qu’un leurre. Cela peut rappeler la phrase ironique du nihiliste Schopenhauer : tu n’as aucune chance mais saisis-là…

Dans le livre Célébrations du bonheur, le professeur de philosophie Emmanuel Jaffelin nous propose un plan simple et efficace, inspiré du stoïcisme, pour aborder la question du bonheur en trois parties : le Malheur, l’Heur, Le Bonheur.
L’Homme reste un être mortel. Malgré tout le progrès réalisé par les siècles successifs, l’angoisse de la mort, chère à Heidegger, est toujours aussi vivace. Nous constatons d’ailleurs, que plus l’être humain vit vieux, moins il est heureux.
D’où vient le malheur ?
A l’époque du polythéisme de l’Antiquité, le malheur s’expliquait par la fatalité du destin. Sont apparues ensuite les théories monothéistes comme le judaïsme, le christianisme et l’islam, qui créèrent la notion du « péché ». Le malheur a été alors mêlé à une notion de culpabilité. Aujourd’hui, l’homme moderne, dépourvu de transcendance, n’a qu’une vie « one shot », où tout s’arrête le jour de la mort et pour lequel le malheur n’a plus d’explication transcendantale. La vie linéaire sans conscience crée une insubmersible angoisse.
Face à ce malheur, Epictète, Bill Le sauvage, Thérèse de Lisieux, Stephen Hawking, et Jean-Dominique Bauby ont fait le choix du bonheur envers et contre tout. Pour faire face au sentiment du malheur, il est au préalable nécessaire de distinguer le « méchant » du « malheur ». Le malheur reste une interprétation psychique, une faiblesse d’interprétation. Le méchant en revanche est un faible incapable de maîtriser ses passions. Il finit mal parce qu’il pratique le mal… Le malheur doit être subi surtout par le méchant, seul responsable de son malheur.
Pourquoi faut-il se méfier de l’heur ?
« Heur » est un terme masculin qui veut dire chance, contrairement à « heure » qui désigne une unité de temps. Emmanuel Jaffelin démontre que l’heur est une montée d’adrénaline comme le coup de foudre, qui se termine toujours mal … comme une tragédie. Cela rejoint la vision des pessimistes comme Freud ou Schopenhauer selon laquelle le désir est insatiable. D’après lui, être touché par la chance ne présume rien de mieux que le malheur. C’est le côté excessif de « l’heur », un peu comme les coups de foudre amoureux qui chutent à la vitesse de la disparition progressive des phéromones. L’heur est donc souvent un leurre. Pour échapper au malheur, il convient de ne pas se laisser piéger par l’heur.
Le bonheur, la marque joyeuse du sage
Face à un évènement négatif, on peut s’attrister, accepter, se résigner… Mais Emmanuel Jaffelin va plus loin : il nous propose de l’aimer ! Les stoïciens nous conseillent d’apprendre à distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui ne l’est pas. L’auteur nous invite à devenir des destinalistes : des hypervoyants et libres, contrairement aux fatalistes qui sont non voyants et esclaves de leur destin. Le bonheur est donc d’apprendre à ne pas dépendre de « l’Heur ».
Sur le plan des neurosciences, on peut rapprocher le lâcher prise stoïcien à la pleine conscience qui nous aide à nous décrocher de nos préjugés. « Vivre dans l’instant présent » nous aide à fabriquer de la sérotonine, qui joue un rôle dans le sentiment de contentement et de plénitude.
Le stoïcisme est un début de cheminement vers le bonheur, car il est une initiation au lâcher prise. Mais est-il suffisant ? Ne faut-il pas également un petit brin de créativité pour réinventer sa réalité ?
Ce qui demeure néanmoins certain est qu’Épictète, Bill Sauvage durant la Seconde guerre mondiale, Sainte Thérèse au XIXe siècle, Stephen Hawking ainsi que le journaliste Jean-Dominique Baudry, tous cités dans ce livre, sont des êtres inspirants, car ils ne cèdent pas à la victimisation. Ils ont le courage et l’impertinence de dépasser les événements fâcheux « pour faire de leur existence une énergie conduisant au Bonheur ».
Emmanuel Jaffelin, Célébrations du Bonheur, Guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux, Michel Lafon, septembre 2021, 175 pages.
L’Homme reste un être mortel. Malgré tout le progrès réalisé par les siècles successifs, l’angoisse de la mort, chère à Heidegger, est toujours aussi vivace. Nous constatons d’ailleurs, que plus l’être humain vit vieux, moins il est heureux.
D’où vient le malheur ?
A l’époque du polythéisme de l’Antiquité, le malheur s’expliquait par la fatalité du destin. Sont apparues ensuite les théories monothéistes comme le judaïsme, le christianisme et l’islam, qui créèrent la notion du « péché ». Le malheur a été alors mêlé à une notion de culpabilité. Aujourd’hui, l’homme moderne, dépourvu de transcendance, n’a qu’une vie « one shot », où tout s’arrête le jour de la mort et pour lequel le malheur n’a plus d’explication transcendantale. La vie linéaire sans conscience crée une insubmersible angoisse.
Face à ce malheur, Epictète, Bill Le sauvage, Thérèse de Lisieux, Stephen Hawking, et Jean-Dominique Bauby ont fait le choix du bonheur envers et contre tout. Pour faire face au sentiment du malheur, il est au préalable nécessaire de distinguer le « méchant » du « malheur ». Le malheur reste une interprétation psychique, une faiblesse d’interprétation. Le méchant en revanche est un faible incapable de maîtriser ses passions. Il finit mal parce qu’il pratique le mal… Le malheur doit être subi surtout par le méchant, seul responsable de son malheur.
Pourquoi faut-il se méfier de l’heur ?
« Heur » est un terme masculin qui veut dire chance, contrairement à « heure » qui désigne une unité de temps. Emmanuel Jaffelin démontre que l’heur est une montée d’adrénaline comme le coup de foudre, qui se termine toujours mal … comme une tragédie. Cela rejoint la vision des pessimistes comme Freud ou Schopenhauer selon laquelle le désir est insatiable. D’après lui, être touché par la chance ne présume rien de mieux que le malheur. C’est le côté excessif de « l’heur », un peu comme les coups de foudre amoureux qui chutent à la vitesse de la disparition progressive des phéromones. L’heur est donc souvent un leurre. Pour échapper au malheur, il convient de ne pas se laisser piéger par l’heur.
Le bonheur, la marque joyeuse du sage
Face à un évènement négatif, on peut s’attrister, accepter, se résigner… Mais Emmanuel Jaffelin va plus loin : il nous propose de l’aimer ! Les stoïciens nous conseillent d’apprendre à distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui ne l’est pas. L’auteur nous invite à devenir des destinalistes : des hypervoyants et libres, contrairement aux fatalistes qui sont non voyants et esclaves de leur destin. Le bonheur est donc d’apprendre à ne pas dépendre de « l’Heur ».
Sur le plan des neurosciences, on peut rapprocher le lâcher prise stoïcien à la pleine conscience qui nous aide à nous décrocher de nos préjugés. « Vivre dans l’instant présent » nous aide à fabriquer de la sérotonine, qui joue un rôle dans le sentiment de contentement et de plénitude.
Le stoïcisme est un début de cheminement vers le bonheur, car il est une initiation au lâcher prise. Mais est-il suffisant ? Ne faut-il pas également un petit brin de créativité pour réinventer sa réalité ?
Ce qui demeure néanmoins certain est qu’Épictète, Bill Sauvage durant la Seconde guerre mondiale, Sainte Thérèse au XIXe siècle, Stephen Hawking ainsi que le journaliste Jean-Dominique Baudry, tous cités dans ce livre, sont des êtres inspirants, car ils ne cèdent pas à la victimisation. Ils ont le courage et l’impertinence de dépasser les événements fâcheux « pour faire de leur existence une énergie conduisant au Bonheur ».
Emmanuel Jaffelin, Célébrations du Bonheur, Guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux, Michel Lafon, septembre 2021, 175 pages.
Les Editions des instants ont eu la bonne idée de dépoussiérer des lectures oubliées du XIXème siècle, pourtant si actuelles : les écrits de Challemel-Lacour sur le pessimisme et ses plus dignes représentants tels que Schopenhauer et Pascal. Ce livre rassemble les textes publiés dans Etudes et réflexions d’un pessimiste publiés en 1901 et en 1993 chez Fayard, ainsi que l’article Un bouddhiste contemporain en Allemagne paru en 1870 dans la Revue des Deux mondes. Paul-Armand Challemel-Lacour a été académicien et normalien, reçu premier à l’agrégation de philosophie. Tout comme de nombreux de ses contemporains, il a connu l’exil politique. Et le sentiment d’exil que ressent tout être d’une extrême lucidité, car le pessimisme est un exil…
Il faut savoir qu’au XIXème siècle, Schopenhauer n’était pas encore très connu en France. Notre philosophe allemand a néanmoins intrigué trois voyageurs français qui ont eu l’audace de le rencontrer et de se frotter à sa philosophie parabolique des « porcs-épics » : Frédéric Morin (en 1858), Foucher de Careil (en 1859) ainsi que Challemel-Lacour (également en 1859). Ce dernier n’a pas publié tout de suite les impressions de cette rencontre hallucinante, il a attendu dix ans avant de relater son voyage au sein du bouddhisme revisité dans une taverne schopenhauerienne. Il faut croire que la noirceur de l’inespoir met du temps à être digérée…
Le concept de l’inespoir, cette sagesse stoïcienne, demeure le fer de lance de la philosophie d’André Comte-Sponville qui a réalisé la préface de cette nouvelle édition. Rien de plus décevant dans la vie que de continuer à espérer… La pensée positive donne à Comte-Sponville le mal de mer qu’il compare à un excès de sucre. Il cite en écho de sa pensée cette phrase d’Aragon « C’est de leur malheur que peut fleurir l’avenir des hommes, et non pas de ce contentement de soi dont nous sommes perpétuellement assourdis » (La valse des adieux, Louis Aragon). Le bonheur nous rendrait-il trop mous ? Cela rappelle inévitablement le style aride et incisif de Cioran qui affirmait que seul l’échec nous dévoile à nous-même.
Ce n’est pas anodin que Comte-Sponville ait souhaité introduire ces portraits de pessimistes, il partage un point commun crucial avec Schopenhauer : le suicide de l’un de ses parents. Le suicide du père pour Schopenhauer fut un traumatisme, comme le fût probablement celui de la mère de Comte-Sponville. Pourtant ce dernier affirme que les pessimistes se suicident rarement car l’espérance est la principale cause du suicide. Selon lui, c’est davantage l’illusion qui cause la souffrance que la vérité. Mais cette théorie sur le suicide vient d’être bousculée récemment par le suicide soudain de Roland Jaccard (en septembre 2021), un fervent défenseur des penseurs nihilistes, qui lui-aussi a eu l’amère expérience de connaître les suicides de son père et de son grand-père. A rebours de la vision optimiste de Comte-Sponville sur le pessimisme, on peut alors penser que le pessimisme provient d’une déchirure dont on ne se remet jamais…. Et qui nous ôte toute illusion, même sur la mort.
La famille des pessimistes est remarquablement bien organisée et soudée, c’est grâce à Cioran que Roland Jaccard a découvert le « bréviaire » pessimiste de Challemel-Lacour, « ce viatique pour âmes ulcérées » écrit-il dans son livre La tentation nihiliste. Le destin de Challemel-Lacour a d’ailleurs intrigué Roland Jaccard, par sa capacité d’embrasser à la fois les théories les plus nihilistes avec un engagement politique sans faille. On se demande en outre si le regard lucide et extraordinaire de Schopenhauer « avec son habit démodé, son jabot de dentelle et sa cravate blanche, sa figure ridée et sèche » que. R. Jaccard décrit dans Le cimetière de la morale n’a pas été inspiré par le portrait que dresse Challemel-Lacour dans ces portraits de pessimistes.
Cette nouvelle édition sur les écrits de Challemel-Lacour ouvre le bal avec l’apparition d’un jeune homme « d’une gravité au-dessus de son âge », qui n’est autre que le spectre d’Hamlet. Accoudé à côté de la cheminée, le narrateur écoute attentivement les mises en garde d’Hamlet et se laisse subjugué par ce logogriphe bizarre. Le pessimisme est assurément un langage atemporel, il ne prend aucune ride. Comme une enclume, il vous assure une stabilité sans faille. Les propos de Hamlet sont d’une troublante actualité : « Tu compares orgueilleusement la police de vos sociétés organisées pour la protection des fortunes, du bien-être et du repos, avec l’anarchie du passé (…). En échange de tant de bienfaits, que t’ont-elles demandé ? Tout au plus de renoncer à une agitation onéreuse, d’accepter qu’on te mesure prudemment l’air, l’espace, la parole, la pensée, la foi religieuse, l’enthousiasme, de consentir à trouver à l’entrée de toutes les routes un gardien qui te demande où tu vas ». Le pessimiste, contrairement à l’optimiste béat et bien organisé, refuse l’idée d’une destination. Selon Challemel-Lacour, la sérénité de Shakespeare provient de trois convictions : l’acceptation du sort, la fatalité des passions, et que paradoxalement sans passion, l’homme n’est rien. Aucune illusion chez Shakespeare, il ne croit pas comme Descartes que l’on puisse maîtriser ses passions.
Les portraits continuent avec Pascal, Byron et Shelley et Leopardi. Quel rapport entre le penseur janséniste Pascal et les insolents Byron et Shelley ? Ils ne daignent porter aucun masque. Ils sont lucides et fatalistes. Le philosophe Alain soutenait que l’optimisme était de volonté. Être pessimiste serait-il alors synonyme d’un « laisser-aller » ? Difficile d’imaginer les poètes romantiques et Pascal se laisser aller… Non, le pessimisme est une école plus subtile.
Le livre poursuit en consacrant la moitié de son épopée nihiliste à la pensée noire de Schopenhauer que Challemel eut l’audace de rencontrer à l’aube de ses 72 ans avec « les cheveux et la barbe entièrement blancs », avec « les yeux et le geste d’un jeune homme » et une bouche aussi sarcastique que sa pensée. Il avait appelé son chien « Atma » : âme du monde en sanscrit. Schopenhauer appréciait l’intelligence animale sans la dissimulation humaine. Toutes les illusions valsent au contact de cet intraitable « bouddhiste » allemand : L’amour ? un leurre pour perpétuer l’espèce. Le progrès ? une chimère du XIXème siècle, tout comme l’était la résurrection des morts au Xème siècle. Le monde n’est pour lui qu’un phénomène cérébral. Seul salut : le nirvana, l’anéantissement volontaire.
La conception du désir et de l’amour du philosophe allemand est ressentie comme un « souffle glacé » par le normalien français. Challemel n’est pas du tout convaincu par cette vision nihiliste de l’amour. Il pense que Schopenhauer pousse le vice trop loin. Challemel conclut à l’occasion d’un article rédigé sur Les Contemplations de Victor Hugo qu’il existe « une même loi pour la nature entière, vivre et souffrir, un même remède l’amour » (Schopenhauer en France un mythe naturaliste, René-Pierre Colin, 1979). Même Schopenhauer n’eut pas l’art d’avoir toujours raison…
Peut-être que Challemel serait finalement d’accord avec la confession de Houellebecq sur son premier coup de cœur philosophique En présence de Schopenhauer (Editions de l’Herne, 2017) : "L'attitude intellectuelle de Schopenhauer reste un modèle pour tout philosophe à venir (…) même si l'on se retrouve au bout du compte en désaccord avec lui, on ne peut qu'éprouver à son égard un profond sentiment de gratitude".
Le pessimisme du XIXème siècle a une saveur particulière qui mérite que l’on y goûte, car le sourire de l’ironie n’est jamais très loin.
Portraits de pessimistes, 2021, 168 pages, 15 €
Paul-Armand Challemel-Lacour, Editions des instants
Le concept de l’inespoir, cette sagesse stoïcienne, demeure le fer de lance de la philosophie d’André Comte-Sponville qui a réalisé la préface de cette nouvelle édition. Rien de plus décevant dans la vie que de continuer à espérer… La pensée positive donne à Comte-Sponville le mal de mer qu’il compare à un excès de sucre. Il cite en écho de sa pensée cette phrase d’Aragon « C’est de leur malheur que peut fleurir l’avenir des hommes, et non pas de ce contentement de soi dont nous sommes perpétuellement assourdis » (La valse des adieux, Louis Aragon). Le bonheur nous rendrait-il trop mous ? Cela rappelle inévitablement le style aride et incisif de Cioran qui affirmait que seul l’échec nous dévoile à nous-même.
Ce n’est pas anodin que Comte-Sponville ait souhaité introduire ces portraits de pessimistes, il partage un point commun crucial avec Schopenhauer : le suicide de l’un de ses parents. Le suicide du père pour Schopenhauer fut un traumatisme, comme le fût probablement celui de la mère de Comte-Sponville. Pourtant ce dernier affirme que les pessimistes se suicident rarement car l’espérance est la principale cause du suicide. Selon lui, c’est davantage l’illusion qui cause la souffrance que la vérité. Mais cette théorie sur le suicide vient d’être bousculée récemment par le suicide soudain de Roland Jaccard (en septembre 2021), un fervent défenseur des penseurs nihilistes, qui lui-aussi a eu l’amère expérience de connaître les suicides de son père et de son grand-père. A rebours de la vision optimiste de Comte-Sponville sur le pessimisme, on peut alors penser que le pessimisme provient d’une déchirure dont on ne se remet jamais…. Et qui nous ôte toute illusion, même sur la mort.
La famille des pessimistes est remarquablement bien organisée et soudée, c’est grâce à Cioran que Roland Jaccard a découvert le « bréviaire » pessimiste de Challemel-Lacour, « ce viatique pour âmes ulcérées » écrit-il dans son livre La tentation nihiliste. Le destin de Challemel-Lacour a d’ailleurs intrigué Roland Jaccard, par sa capacité d’embrasser à la fois les théories les plus nihilistes avec un engagement politique sans faille. On se demande en outre si le regard lucide et extraordinaire de Schopenhauer « avec son habit démodé, son jabot de dentelle et sa cravate blanche, sa figure ridée et sèche » que. R. Jaccard décrit dans Le cimetière de la morale n’a pas été inspiré par le portrait que dresse Challemel-Lacour dans ces portraits de pessimistes.
Cette nouvelle édition sur les écrits de Challemel-Lacour ouvre le bal avec l’apparition d’un jeune homme « d’une gravité au-dessus de son âge », qui n’est autre que le spectre d’Hamlet. Accoudé à côté de la cheminée, le narrateur écoute attentivement les mises en garde d’Hamlet et se laisse subjugué par ce logogriphe bizarre. Le pessimisme est assurément un langage atemporel, il ne prend aucune ride. Comme une enclume, il vous assure une stabilité sans faille. Les propos de Hamlet sont d’une troublante actualité : « Tu compares orgueilleusement la police de vos sociétés organisées pour la protection des fortunes, du bien-être et du repos, avec l’anarchie du passé (…). En échange de tant de bienfaits, que t’ont-elles demandé ? Tout au plus de renoncer à une agitation onéreuse, d’accepter qu’on te mesure prudemment l’air, l’espace, la parole, la pensée, la foi religieuse, l’enthousiasme, de consentir à trouver à l’entrée de toutes les routes un gardien qui te demande où tu vas ». Le pessimiste, contrairement à l’optimiste béat et bien organisé, refuse l’idée d’une destination. Selon Challemel-Lacour, la sérénité de Shakespeare provient de trois convictions : l’acceptation du sort, la fatalité des passions, et que paradoxalement sans passion, l’homme n’est rien. Aucune illusion chez Shakespeare, il ne croit pas comme Descartes que l’on puisse maîtriser ses passions.
Les portraits continuent avec Pascal, Byron et Shelley et Leopardi. Quel rapport entre le penseur janséniste Pascal et les insolents Byron et Shelley ? Ils ne daignent porter aucun masque. Ils sont lucides et fatalistes. Le philosophe Alain soutenait que l’optimisme était de volonté. Être pessimiste serait-il alors synonyme d’un « laisser-aller » ? Difficile d’imaginer les poètes romantiques et Pascal se laisser aller… Non, le pessimisme est une école plus subtile.
Le livre poursuit en consacrant la moitié de son épopée nihiliste à la pensée noire de Schopenhauer que Challemel eut l’audace de rencontrer à l’aube de ses 72 ans avec « les cheveux et la barbe entièrement blancs », avec « les yeux et le geste d’un jeune homme » et une bouche aussi sarcastique que sa pensée. Il avait appelé son chien « Atma » : âme du monde en sanscrit. Schopenhauer appréciait l’intelligence animale sans la dissimulation humaine. Toutes les illusions valsent au contact de cet intraitable « bouddhiste » allemand : L’amour ? un leurre pour perpétuer l’espèce. Le progrès ? une chimère du XIXème siècle, tout comme l’était la résurrection des morts au Xème siècle. Le monde n’est pour lui qu’un phénomène cérébral. Seul salut : le nirvana, l’anéantissement volontaire.
La conception du désir et de l’amour du philosophe allemand est ressentie comme un « souffle glacé » par le normalien français. Challemel n’est pas du tout convaincu par cette vision nihiliste de l’amour. Il pense que Schopenhauer pousse le vice trop loin. Challemel conclut à l’occasion d’un article rédigé sur Les Contemplations de Victor Hugo qu’il existe « une même loi pour la nature entière, vivre et souffrir, un même remède l’amour » (Schopenhauer en France un mythe naturaliste, René-Pierre Colin, 1979). Même Schopenhauer n’eut pas l’art d’avoir toujours raison…
Peut-être que Challemel serait finalement d’accord avec la confession de Houellebecq sur son premier coup de cœur philosophique En présence de Schopenhauer (Editions de l’Herne, 2017) : "L'attitude intellectuelle de Schopenhauer reste un modèle pour tout philosophe à venir (…) même si l'on se retrouve au bout du compte en désaccord avec lui, on ne peut qu'éprouver à son égard un profond sentiment de gratitude".
Le pessimisme du XIXème siècle a une saveur particulière qui mérite que l’on y goûte, car le sourire de l’ironie n’est jamais très loin.
Portraits de pessimistes, 2021, 168 pages, 15 €
Paul-Armand Challemel-Lacour, Editions des instants
Tags :
schopenhauer
 LIVRES PHILous
LIVRES PHILous
Mercredi 30 Décembre 2020
A mi-chemin entre le récit et l’essai, Adèle Van Reeth nous invite à poser un regard philosophique sur nos vies ordinaires, sur cette banalité du quotidien qui à la fois nous rassure et nous agace. L’ordinaire, cet étrange malaise nommé par Baudelaire, « Anywhere out the world », ou encore ce sentiment visqueux si bien décrit dans La nausée de Sartre, A. Van Reeth le confronte à la lumière de la philosophie américaine que l’on connaît peu en France. Ce livre est la possibilité d’une rare et délicieuse rencontre avec des philosophes américains atypiques et novateurs comme Ralph Waldo Emerson, Stanley Cavell et Henry David Thoreau.

« Pourquoi la vie possible est-elle plus séduisante que la vie ordinaire ? »
Le tête-à-tête chaleureux autour de sushis ordinaires entre Adèle Van Reeth et le philosophe Stanley Cavell rappelle l’ambiance loufoque des rencontres imaginées par Roland Jaccard dans Le cimetière de la morale (PUF, 1995). Ces ambiances de cafés ou d’hôtels où le temps semble s’être arrêté pour laisser place à une discussion avec les plus grands esprits des siècles passés. La différence est que Roland Jaccard nous fait voyager dans les profondeurs de la philosophie allemande, alors qu’Adèle Van Reeth nous offre un décor Midwest et décontracté pour se plonger dans la pensée de l’ordinaire. Nous sommes loin du regard lucide et extraordinaire de Schopenhauer « avec son habit démodé, son jabot de dentelle et sa cravate blanche, sa figure ridée et sèche » où « Le travail se lit » sur sa figure (Le cimetière de la morale, R. Jaccard). Adèle Van Reeth nous arrache de la philosophie grandiose allemande pour mettre le cap sur les Etats-Unis, ce pays que l’on juge souvent trop hâtivement comme non philosophe. « Comme si la haute culture avait été préemptée par le vieux continent, il ne restait aux Américains que les miettes, la culture de bas étage et les soucis ordinaires. ». En partant étudier à Chicago, Adèle Van Reeth a découvert que l’ordinaire avait le droit de cité en philosophie grâce à Emerson. Elle décide alors de prendre l’avion pour New York puis le bus jusqu’à Boston pour rencontrer Stanley Cavell, fils spirituel d’Emerson. « Dégustant patiemment l’assiette de Sushis qu’il avait commandés pour nous deux (les premiers de ma vie), il déplia pour moi le contenu de ses analyses en décortiquant des crevettes ». Mais l’ordinaire n’est pas un plat facile : « Oh but you see… L’ordinaire n’est pas un concept. C’est une quête ».
En effet, l’ordinaire est une quête complexe. On y sent un goût duel, à la fois amer et doux : le goût français plutôt visqueux que Sartre a mis en évidence ou le goût américain des petits riens sur lesquels Emerson s’extasie. L’ordinaire peut provoquer le cafard ou à l’inverse un retour vers soi, un « remariage » comme l’explique Stanley Cavell dans son livre A la recherche du bonheur. Emerson s’enthousiasme sur les petits riens de l’existence : « La viande qui rôtit dans l’âtre, le lait qui chauffe dans la casserole, la chanson que l’on fredonne dans la rue ». Ce philosophe est fier de montrer qu’il faut prêter attention à autre chose que le grandiose et estime que la philosophie européenne est trop ancrée dans le romantisme, qu’elle « ne jure que par le sublime et le grandiose ». Or Stanley Cavell pense qu’une transformation de soi « ne peut se faire qu’au prix d’une certaine attention accordée à l’ordinaire ».
Tout comme Emerson et Cavell, Adèle Van Reeth ne semble pas sensible au grandiose. Très lucide sur l’absurdité de l’existence, elle a un dégoût pour la célébration du quotidien. La jouissance est peut-être une question de caractère. C’est ce qui la distingue de la joie. Cependant, contrairement à Spinoza, la joie, façon « hymne de Beethoven », n’est pas pour elle le but ultime. « D’Aristote à Spinoza l’éloge de la joie m’avait profondément ennuyée ». Elle est davantage attirée par l’état sauvage d’Henry David Thoreau. « Pourquoi l’état sauvage fait-il tant rêver ? Parce qu’on se dit que ce qui est sauvage est tout sauf ordinaire. »
Et malheureusement le quotidien n’a pas la beauté du sauvage, il est une succession de contraintes, « d’épines domestiques » comme les appelait Montaigne. Faire la vaisselle, déboucher l’évier, laver le linge … Ces contraintes qui « empêchent le travail de l’esprit ». C’est pour cette raison que Virginia Woolf voulait pour pouvoir écrire tuer « l’ange du foyer », la vie domestique. Adèle Van Reeth souligne que finalement Emerson qui glorifiait l’ordinaire s’est cogné à la même impasse que Virginia Woolf qui voulait s’affranchir de la vie domestique : la mélancolie. La mort prématurée du fils d’Emerson a suscité le même chagrin que l’absence d’enfant de V. Woolf. Triste fatalité, l’ordinaire ne sauve pas de la mélancolie du quotidien.
La naissance : une séparation que l’ordinaire essaie de réparer ?
Le récit de ce livre est subtil car il vient appuyer les arguments philosophiques énoncés. En effet, notre animatrice des « chemins de la philosophie » débute son roman sur le thème de la rupture, la séparation : celle de la naissance d’un enfant qui est séparé du ventre de sa mère. « Ta naissance sera une rupture ». C’est la rupture qui permet la rencontre entre une mère et son bébé. « Le drame ce n’est pas la rupture, le drame, c’est ce dont la rupture veut venir à bout : l’inéluctable condition ordinaire de notre existence qui nous assoiffe d’extraordinaire ». A. Van Reeth met en miroir deux opposés : d’un côté la naissance, la grossesse qui est un phénomène extraordinaire dans la vie d’une femme et de l’autre la mort, celle prévisible de son père malade que l’on découvre à la fin du livre et qui se console avec des fragments de la vie ordinaire. La grossesse « boostée aux hormones » avec ses « nuages roses » détrône l’ordinaire. Mais la naissance reste une séparation comme la mort. Et la philosophie de l’ordinaire nous permet de nous « remarier » avec nous-même. Pourtant la théorie d’Emerson semble échouer lorsqu’il perd son fils. Cette mort est gratuite, le chagrin d’un être perdu n’enseigne rien. La douleur n’apprend que l’insignifiance.
La mise en parallèle de sa grossesse avec la fin possible de son père ainsi que la description d’un avortement rappelle l’absurdité de notre existence, thème prédominant dans l’œuvre de Camus ou encore La nausée de Sartre. Ainsi, après le voyage américain exotique de la philosophie sur l’ordinaire, nous revenons tout doucement en France avec Sartre, Camus (où nous pouvons apprécier la visite d’A. Van Reeth chez Catherine Camus dans sa maison à Lourmarin) et Clément Rosset.
« La lecture du roman de Sartre m’avait aidé à formuler le type de trouble que les moments ordinaires faisaient jaillir de manière spectaculaire ». « La répugnance du visqueux (…) le risque d’être bu par les choses « comme l’encre dans un buvard », c’est mon mode d’être au monde. Quand Camus jouit, Sartre vomit et je porte les deux en moi ».
Nous avons en chacun de nous une dualité. Adèle Van Reeth en illustre parfaitement l’intranquillité qui en découle de façon visqueuse. Elle se refuse à la fin du dualisme prôné par Spinoza et aux sirènes libératrices de la joie. Elle préfère s’en remettre à l’ordinaire nonchalant qui nous sauve du caractère tragique de la mort.
« Le bitume imbibé du soleil de juin nous aveugle, tu déplaces ton visage à l’ombre des branches, tu as oublié tes lunettes de soleil, je te propose les miennes, tu acceptes et c’est moi qui ne vois plus rien ».
La vie ordinaire, Adèle Van Reeth, Gallimard 2020.

Alors que la psychanalyse subit actuellement des assauts violents de la pensée conformiste, Samuel Dock nous offre un voyage sincère sous forme d’abécédaire palpitant sur cette «psychologie des profondeurs». On en ressort tout ébouriffé et enthousiaste... Loin de sentir la naphtaline, Samuel revigore l’indocilité de la psychanalyse que l’on avait oubliée. Il y ressuscite l’inquiétante étrangeté qu’avait su créée Freud lors de sa théorie explosive et adoucit les querelles de chapelle (ou plutôt de divans) entre les freudiens, les lacaniens, les kleiniens ou les jungiens...
Son essai refuse le catéchisme dogmatique, les remparts artificiels créés par les différentes obédiences psychanalytiques, disons-le franchement : l’élitisme abscons. Il libère la psychanalyse contemporaine de sa tour d’ivoire bourgeoise, en rendant la psychanalyse lisible et accessible, en prenant même le risque de se dévoiler lui-même.
Rappelons-nous du séisme profond qu'avait provoqué Freud...
En 1900, lorsque Freud publia L’interprétation des rêves, c’était un tremblement de terre qui ouvrait les portes mystérieuses de l’inconscient. On a tendance à l’enterrer, mais la psychanalyse a été rebelle, loin de la mollesse des divans. Cette inquiétante étrangeté, Samuel Dock l’illustre par « toutes ces délectables bizarreries, toutes ces merveilles incommodantes ». Comme un « reflet bien familier » qui nous remue. C’est alors que le refoulé affleure notre conscience et que l’on peut apprécier « l’irruption d’un continent de mon identité ». C’est cela l’inquiétante étrangeté, un paradoxe : une reconnaissance suivie d’un inconfort. C’est cette fusion entre le réel et l’irréel qui déstabilise. Cette confusion est bien prégnante dans les œuvres de David Lynch. L’auteur emploie cette formidable allégorie pour décrire ce concept d’étrangeté : « le surgissement du fantastique au cœur du quotidien le plus banal ».
Après ce séisme profond, quel crédit accordé alors au marketing du coaching ? La psychanalyse n’a pas peur des abymes de l’inconscient, contrairement à certaines techniques du développement personnel qui agissent comme des « adjuvants » sur « l’être hypermoderne » sur ses « microprojets » gérés en toute urgence. Comment retrouver de l’unité dans cette agitation incessante de patchwork de coachs en tout genre ? La psychanalyse permet de retrouver une intériorité, contrairement au « sparadrap » du coaching. D’après Samuel Dock, la pensée positive serait une dictature du conformisme, ne jamais se plaindre, continuer à avancer, ne surtout pas trop penser. Or combien de fois entendons-nous « tu penses trop » ? Respecter ses blessures, ne pas nier ses souffrances, c’est en cela que la psychanalyse, à cause de ce réalisme, plaît moins à une société capitaliste qui privilégie l’urgence.
L'erreur de Bettelheim sur les causes de l'autisme
Cependant, même si le mot clé de l’abécédaire « contes de fée » fait rêver, attention, la psychanalyse porte aussi ses propres blessures. Samuel Dock nous fait prendre du recul par rapport à l’auteur de la Psychanalyse des contes de fées : Bruno Bettelheim. Son interprétation des causes de l’autisme a jeté un discrédit sur la psychanalyse : Bettelheim accusait les mères « réfrigérateurs » de provoquer l’autisme…
De l'importance des "mots" (maux) en psychanalyse et de la nuance, si chère à Nietzsche
Pourtant, les mots ont leur importance en psychanalyse, la nuance est reine. On apprend par exemple la différence entre déni et dénégation. Cet abécédaire dévoile l’humanité d’un vocabulaire parfois trop ésotérique. Et surtout nous donne de nouvelles clés d’entrée pour interpréter les symptômes. L’addiction, par exemple, peut paraître simple comme sujet, or la psychanalyse en offre un prisme d’interprétation loin de sentiers battus : « la solution addictive représenterait non pas une manière de se détruire, comme le suggère le terme « toxicomanie » par exemple, mais bien une tentative d’autoguérison face à la menace de stress psychique ». L’addiction, un moyen de se guérir ? La psychanalyse a ce point commun avec la philosophie, celle de savoir poser les bonnes questions et de démêler les multi-causalités d’un symptôme.
On sourit par ailleurs lorsque l’auteur se gausse de ce qu’est devenu le concept du fantasme : « cinquante nuances de vide ». Le fantasme, pourtant « preuve de la vitalité de notre psyché », s’est stéréotypé. Il s’agit d’un « fantasme dilué, inodore, incolore », tout à fait conformiste. Cette dilution trouve sa cause dans le cannibalisme. En effet, le terme « cannibalisme » peut paraître saugrenu dans un abécédaire sur la psychanalyse alors qu’en fait il mérite toute sa place : Ne serions-nous pas en train « de nous cannibaliser les uns les autres ? Sevrés du sein maternel, l’hyperconsommation nous fait croire que nous devenons ce que nous incorporons. Mais est-ce suffisant pour nous combler ? Pas tout à fait, car le pervers narcissique n’est autre que le symptôme de « cette horde primitive », « la métaphore de cette hyperconsommation du soi ». Nous sommes dans un hédonisme de survie, qui masque un certain cannibalisme narcissique.
Pour lutter contre ce cannibalisme, heureusement persiste notre joyeuse créativité. Mais, Freud dans le Malaise d’une civilisation refroidit notre optimisme sur l’art salvateur « Qui est réceptif à l’influence de l’art l’apprécie plus que tout, comme source de plaisir et comme réconfort dans l’existence. Néanmoins, la douce Narcose où nous plonge l’art n’est pas capable de provoquer plus qu’une brève évasion loin des malheurs de la vie et elle n’est pas assez forte pour faire oublier la détresse réelle ». Ce pessimisme freudien peut difficilement se conjuguer avec les dictats de notre société qui prône une jouissance de l’instant pour nous perfuser d’images positives. C’est probablement ce côté un peu schopenhauerien de la psychanalyse qui déplaît aujourd’hui, voire qui fait peur…
Mais cet abécédaire sait mettre aussi parfaitement en valeur le côté lumineux de la psychanalyse, son art de l’interprétation. Cette magie du déchiffrage nous ouvre sans cesse des nouvelles portes. Une maison, par exemple, l’auteur voit notre habitat comme un troisième corps. « On investit notre maison à la façon dont notre corps a été investi par les soins maternels ». La maison d’un paranoïaque sera de ce fait très différente de celle d’un obsessionnel. Pour les couples, le logement, « véritable investissement libidinal » peut devenir carrément une personne tierce. Une maison, comme un amant ? Voilà pourquoi la psychanalyse reste fascinante, car elle transforme notre banalité quotidienne en véritable scène surréaliste.
"Freud n'est pas Kant", la psychanalyse doit rester indocile
Le titre de cet essai n’est pas anodin : la psychanalyse doit être indocile, sa survie en dépend. L’auteur défend résolument une approche interdisciplinaire, celle de Freud : prendre en compte tout l’écosystème des symptômes individuels, les groupes, les institutions comme l’armée ou la religion, les mythes, la civilisation. La psychanalyse à l’époque de Freud essayait d’embrasser la complexité du monde, en apportant un coup de marteau à la rationalité. « Je est un autre ». Pourquoi avoir renoncé à cette anthropologie psychanalytique ? Fuir le catéchisme des différentes écoles de psychanalyse, la complaisance institutionnelle, est essentiel pour se concentrer sur le patient.
« Freud n’est pas Kant ». Notre humanité ne colle pas aux images d’Epinal. Il est nécessaire d’étudier toutes les sciences humaines, y compris les approches opposées à la psychanalyse pour se rappeler qu’il existe « toujours d’autres façons de penser l’humain ». « Nous sommes divisés en des milliers d’influences contraires ».
Le manque est garant de notre humanité, voilà la devise de cette éloge indocile, loin de l’hystérique consommation contemporaine.
Merci à Samuel Dock pour cette indocilité érudite.
Rappelons-nous du séisme profond qu'avait provoqué Freud...
En 1900, lorsque Freud publia L’interprétation des rêves, c’était un tremblement de terre qui ouvrait les portes mystérieuses de l’inconscient. On a tendance à l’enterrer, mais la psychanalyse a été rebelle, loin de la mollesse des divans. Cette inquiétante étrangeté, Samuel Dock l’illustre par « toutes ces délectables bizarreries, toutes ces merveilles incommodantes ». Comme un « reflet bien familier » qui nous remue. C’est alors que le refoulé affleure notre conscience et que l’on peut apprécier « l’irruption d’un continent de mon identité ». C’est cela l’inquiétante étrangeté, un paradoxe : une reconnaissance suivie d’un inconfort. C’est cette fusion entre le réel et l’irréel qui déstabilise. Cette confusion est bien prégnante dans les œuvres de David Lynch. L’auteur emploie cette formidable allégorie pour décrire ce concept d’étrangeté : « le surgissement du fantastique au cœur du quotidien le plus banal ».
Après ce séisme profond, quel crédit accordé alors au marketing du coaching ? La psychanalyse n’a pas peur des abymes de l’inconscient, contrairement à certaines techniques du développement personnel qui agissent comme des « adjuvants » sur « l’être hypermoderne » sur ses « microprojets » gérés en toute urgence. Comment retrouver de l’unité dans cette agitation incessante de patchwork de coachs en tout genre ? La psychanalyse permet de retrouver une intériorité, contrairement au « sparadrap » du coaching. D’après Samuel Dock, la pensée positive serait une dictature du conformisme, ne jamais se plaindre, continuer à avancer, ne surtout pas trop penser. Or combien de fois entendons-nous « tu penses trop » ? Respecter ses blessures, ne pas nier ses souffrances, c’est en cela que la psychanalyse, à cause de ce réalisme, plaît moins à une société capitaliste qui privilégie l’urgence.
L'erreur de Bettelheim sur les causes de l'autisme
Cependant, même si le mot clé de l’abécédaire « contes de fée » fait rêver, attention, la psychanalyse porte aussi ses propres blessures. Samuel Dock nous fait prendre du recul par rapport à l’auteur de la Psychanalyse des contes de fées : Bruno Bettelheim. Son interprétation des causes de l’autisme a jeté un discrédit sur la psychanalyse : Bettelheim accusait les mères « réfrigérateurs » de provoquer l’autisme…
De l'importance des "mots" (maux) en psychanalyse et de la nuance, si chère à Nietzsche
Pourtant, les mots ont leur importance en psychanalyse, la nuance est reine. On apprend par exemple la différence entre déni et dénégation. Cet abécédaire dévoile l’humanité d’un vocabulaire parfois trop ésotérique. Et surtout nous donne de nouvelles clés d’entrée pour interpréter les symptômes. L’addiction, par exemple, peut paraître simple comme sujet, or la psychanalyse en offre un prisme d’interprétation loin de sentiers battus : « la solution addictive représenterait non pas une manière de se détruire, comme le suggère le terme « toxicomanie » par exemple, mais bien une tentative d’autoguérison face à la menace de stress psychique ». L’addiction, un moyen de se guérir ? La psychanalyse a ce point commun avec la philosophie, celle de savoir poser les bonnes questions et de démêler les multi-causalités d’un symptôme.
On sourit par ailleurs lorsque l’auteur se gausse de ce qu’est devenu le concept du fantasme : « cinquante nuances de vide ». Le fantasme, pourtant « preuve de la vitalité de notre psyché », s’est stéréotypé. Il s’agit d’un « fantasme dilué, inodore, incolore », tout à fait conformiste. Cette dilution trouve sa cause dans le cannibalisme. En effet, le terme « cannibalisme » peut paraître saugrenu dans un abécédaire sur la psychanalyse alors qu’en fait il mérite toute sa place : Ne serions-nous pas en train « de nous cannibaliser les uns les autres ? Sevrés du sein maternel, l’hyperconsommation nous fait croire que nous devenons ce que nous incorporons. Mais est-ce suffisant pour nous combler ? Pas tout à fait, car le pervers narcissique n’est autre que le symptôme de « cette horde primitive », « la métaphore de cette hyperconsommation du soi ». Nous sommes dans un hédonisme de survie, qui masque un certain cannibalisme narcissique.
Pour lutter contre ce cannibalisme, heureusement persiste notre joyeuse créativité. Mais, Freud dans le Malaise d’une civilisation refroidit notre optimisme sur l’art salvateur « Qui est réceptif à l’influence de l’art l’apprécie plus que tout, comme source de plaisir et comme réconfort dans l’existence. Néanmoins, la douce Narcose où nous plonge l’art n’est pas capable de provoquer plus qu’une brève évasion loin des malheurs de la vie et elle n’est pas assez forte pour faire oublier la détresse réelle ». Ce pessimisme freudien peut difficilement se conjuguer avec les dictats de notre société qui prône une jouissance de l’instant pour nous perfuser d’images positives. C’est probablement ce côté un peu schopenhauerien de la psychanalyse qui déplaît aujourd’hui, voire qui fait peur…
Mais cet abécédaire sait mettre aussi parfaitement en valeur le côté lumineux de la psychanalyse, son art de l’interprétation. Cette magie du déchiffrage nous ouvre sans cesse des nouvelles portes. Une maison, par exemple, l’auteur voit notre habitat comme un troisième corps. « On investit notre maison à la façon dont notre corps a été investi par les soins maternels ». La maison d’un paranoïaque sera de ce fait très différente de celle d’un obsessionnel. Pour les couples, le logement, « véritable investissement libidinal » peut devenir carrément une personne tierce. Une maison, comme un amant ? Voilà pourquoi la psychanalyse reste fascinante, car elle transforme notre banalité quotidienne en véritable scène surréaliste.
"Freud n'est pas Kant", la psychanalyse doit rester indocile
Le titre de cet essai n’est pas anodin : la psychanalyse doit être indocile, sa survie en dépend. L’auteur défend résolument une approche interdisciplinaire, celle de Freud : prendre en compte tout l’écosystème des symptômes individuels, les groupes, les institutions comme l’armée ou la religion, les mythes, la civilisation. La psychanalyse à l’époque de Freud essayait d’embrasser la complexité du monde, en apportant un coup de marteau à la rationalité. « Je est un autre ». Pourquoi avoir renoncé à cette anthropologie psychanalytique ? Fuir le catéchisme des différentes écoles de psychanalyse, la complaisance institutionnelle, est essentiel pour se concentrer sur le patient.
« Freud n’est pas Kant ». Notre humanité ne colle pas aux images d’Epinal. Il est nécessaire d’étudier toutes les sciences humaines, y compris les approches opposées à la psychanalyse pour se rappeler qu’il existe « toujours d’autres façons de penser l’humain ». « Nous sommes divisés en des milliers d’influences contraires ».
Le manque est garant de notre humanité, voilà la devise de cette éloge indocile, loin de l’hystérique consommation contemporaine.
Merci à Samuel Dock pour cette indocilité érudite.
 LIVRES PHILous
LIVRES PHILous
Dimanche 10 Novembre 2019
« Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur fidèle et a oublié le don », constatait Einstein. Plus de 60 ans après, notre société se montre toujours aussi hostile aux intelligences différentes de la sacro-sainte intelligence logique et verbale. Pour cette raison, j'ai trouvé le témoignage de Valérie Fauchet sur sa mediumnité, dans son livre Une voyante passe aux aveux, fascinant. La voyance est une forme d'hypersensibilité qui défie les lois physiques et spatio-temporelles et qui mérite notre attention, au regard de l'intelligence artificielle versus intelligence humaine.
Il existe, malheureusement, des dons que l’on subit. Certaines personnes possèdent en effet le don de « pré-voir ». Contrairement aux surdoués, les dons de voyance sont jugés douteux et sont ignorés par la science. Pourtant, ces personnes « voyantes » n’ont pas décidé d’avoir ces « flashs », ils s’imposent à eux. Comment faire alors pour ne plus voir ?
Dans ce livre Une voyante passe aux aveux, le témoignage de Valérie Fauchet est troublant, sa vie ressemble à un roman fantastique. Pour donner du coffre à ses expériences, et prouver qu’elle n’a pas peur d’être titillée par l’exigence de preuves factuelles, l’auteure a eu la bonne idée d’être interviewée par une magistrate, Marie-Noëlle Dompé. La voyance au tribunal ? Oui, mais il ne s’agit pas pour autant d’un procès. Cette magistrate, aguerrie à l’impartialité, a joué le rôle de l’investigatrice bienveillante pour comprendre comment se manifeste cette méga intuition chez notre voyante peu commune. La voyance apparaît alors sous un autre jour, plutôt comme une hypersensibilité insoutenable. Comme une faille qui attire la lumière d’un flash. Les gens dotés d’une hypersensibilité sont plus facilement fatigués, car ils absorbent énormément les émotions des autres, voire des objets… Car pour Valérie Fauchet, même les objets portent une histoire. La foule est pour elle tel un vampire, elle l’épuise. Ces phénomènes de clairvoyance sont provoqués par des émotions très fortes. Etymologiquement, émotion veut dire « dérangement ». Les artistes peuvent eux-aussi d’ailleurs avoir cette sensibilité médiumnique. Comme le souligne justement l’auteure, les artistes sont « chacun dans leur genre » des mediums, et pourtant personne ne les craint. Car leur don se manifeste dans une expression artistique, un don qui heureusement est reconnu par nos sociétés.
Son témoignage est à certains moments poignant. On est saisi de compassion lorsqu’elle explique qu’elle a découvert son don, en pressentant 8 jours avant, les futurs attouchements de son instituteur… Mais personne ne s’en alerte. Malgré cet épisode douloureux, sa vie ressemble aussi à un conte de fée. Elle voit par exemple des Elfes dans le jardin de sa maison de Rennes. Un peu comme dans les légendes celtes, elle vit des jours enchantés sur l’île aux moines, île dotée d’une énergie très particulière. Les artistes, et en particulier les poètes, sont ses amis. Elle a par exemple le plaisir d’échanger sur l’onirisme et la poésie avec le peintre brésilien Cicero Dias, ami de Paul Eluard, ouvert à la médiumnité. Après sa période bretonne enchanteresse, elle a le coup de foudre pour un appartement rue de Tournon à Paris, qu’elle transforme en cabinet de curiosités. Une vraie vie de bohème s’ouvre alors à elle. Elle apprend alors qu’une célèbre voyante, Mademoiselle Lenormand, habitait dans cet appartement et qu’elle recevait régulièrement Joséphine de Beauharnais. En somme, une jolie coïncidence.
Mais est-il judicieux d’être marié à une voyante ? On sourit lorsqu’elle relate que son don n’était pas un cadeau pour son ex-mari, car elle visualisait toutes ses maîtresses, et ce même à distance… Son mari ne pouvait pas cultiver de jardin secret. Ce qui peut donner l’impression encombrante et obsessionnelle d’être tout le temps espionné...
La voyance souffre aujourd’hui d’une image délétère, elle est perçue comme la misère de tous les espoirs déçus. Elle est souvent l’appât facile de charlatans qui exploitent le mal être des personnes insatisfaites de leur présent. Cette voyance « bas de gamme » et payante est à l’opposé du « connais-toi toi-même ». On gagne souvent plus de temps à chercher à comprendre l’origine de ses désirs, que de tenter de les assouvir à tout prix. Malgré le charlatanisme qui entoure ce don qui défie les lois spatio-temporelles, la « vraie » voyance ou la médiumnité sont une forme d’intuition. Elles échappent certes à l’intelligence logique, mais appréhendent le monde autrement. Einstein soutenait que « le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur fidèle et a oublié le don ». Notre occident est si rationnel qu’il barre la route à l’intuition. La voyance peut être perçue comme une alchimie des émotions qui nous livre une autre clé d’interprétation de la réalité. A travers son témoignage, l’auteure a cherché à « desorcelliser » la voyance.
Même quand une personne a des « flashs », ces images restent toujours interprétables. Valérie Fauchet insiste sur le fait qu’il n’y a pas de vérité absolue, même sur le passé. Sa voyance est la possibilité « d’offrir un autre regard ». La façon de vivre l’évènement prédit est elle-aussi subjective. Par conséquent, attention à l’hubris : ne jamais prédire des choses de façon catégorique. Le doute cartésien doit être la règle, même dans ce domaine de l’intuition. La médiumnité reste un mystère et n’obéit à aucune loi.
Cet ouvrage souhaite offrir une vision moins matérialiste du monde dans lequel nous vivons.
Valérie Fauchet a parfois l’impression d’être à la fois sur terre et dans l’au-delà. C’est dur de vivre cette dualité, c’est comme le destin de mélusine, mi-femme mi-serpent, ce type de femmes dérange…
Notre monde continue de refuser la complexité.
J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteure, suite à la lecture de son témoignage. Je vous ferai part bientôt de nos échanges dans un prochain article...
Une voyante passe aux aveux, Editions Ipanema 2019, 233 pages, 17,90 €
Dans ce livre Une voyante passe aux aveux, le témoignage de Valérie Fauchet est troublant, sa vie ressemble à un roman fantastique. Pour donner du coffre à ses expériences, et prouver qu’elle n’a pas peur d’être titillée par l’exigence de preuves factuelles, l’auteure a eu la bonne idée d’être interviewée par une magistrate, Marie-Noëlle Dompé. La voyance au tribunal ? Oui, mais il ne s’agit pas pour autant d’un procès. Cette magistrate, aguerrie à l’impartialité, a joué le rôle de l’investigatrice bienveillante pour comprendre comment se manifeste cette méga intuition chez notre voyante peu commune. La voyance apparaît alors sous un autre jour, plutôt comme une hypersensibilité insoutenable. Comme une faille qui attire la lumière d’un flash. Les gens dotés d’une hypersensibilité sont plus facilement fatigués, car ils absorbent énormément les émotions des autres, voire des objets… Car pour Valérie Fauchet, même les objets portent une histoire. La foule est pour elle tel un vampire, elle l’épuise. Ces phénomènes de clairvoyance sont provoqués par des émotions très fortes. Etymologiquement, émotion veut dire « dérangement ». Les artistes peuvent eux-aussi d’ailleurs avoir cette sensibilité médiumnique. Comme le souligne justement l’auteure, les artistes sont « chacun dans leur genre » des mediums, et pourtant personne ne les craint. Car leur don se manifeste dans une expression artistique, un don qui heureusement est reconnu par nos sociétés.
Son témoignage est à certains moments poignant. On est saisi de compassion lorsqu’elle explique qu’elle a découvert son don, en pressentant 8 jours avant, les futurs attouchements de son instituteur… Mais personne ne s’en alerte. Malgré cet épisode douloureux, sa vie ressemble aussi à un conte de fée. Elle voit par exemple des Elfes dans le jardin de sa maison de Rennes. Un peu comme dans les légendes celtes, elle vit des jours enchantés sur l’île aux moines, île dotée d’une énergie très particulière. Les artistes, et en particulier les poètes, sont ses amis. Elle a par exemple le plaisir d’échanger sur l’onirisme et la poésie avec le peintre brésilien Cicero Dias, ami de Paul Eluard, ouvert à la médiumnité. Après sa période bretonne enchanteresse, elle a le coup de foudre pour un appartement rue de Tournon à Paris, qu’elle transforme en cabinet de curiosités. Une vraie vie de bohème s’ouvre alors à elle. Elle apprend alors qu’une célèbre voyante, Mademoiselle Lenormand, habitait dans cet appartement et qu’elle recevait régulièrement Joséphine de Beauharnais. En somme, une jolie coïncidence.
Mais est-il judicieux d’être marié à une voyante ? On sourit lorsqu’elle relate que son don n’était pas un cadeau pour son ex-mari, car elle visualisait toutes ses maîtresses, et ce même à distance… Son mari ne pouvait pas cultiver de jardin secret. Ce qui peut donner l’impression encombrante et obsessionnelle d’être tout le temps espionné...
La voyance souffre aujourd’hui d’une image délétère, elle est perçue comme la misère de tous les espoirs déçus. Elle est souvent l’appât facile de charlatans qui exploitent le mal être des personnes insatisfaites de leur présent. Cette voyance « bas de gamme » et payante est à l’opposé du « connais-toi toi-même ». On gagne souvent plus de temps à chercher à comprendre l’origine de ses désirs, que de tenter de les assouvir à tout prix. Malgré le charlatanisme qui entoure ce don qui défie les lois spatio-temporelles, la « vraie » voyance ou la médiumnité sont une forme d’intuition. Elles échappent certes à l’intelligence logique, mais appréhendent le monde autrement. Einstein soutenait que « le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur fidèle et a oublié le don ». Notre occident est si rationnel qu’il barre la route à l’intuition. La voyance peut être perçue comme une alchimie des émotions qui nous livre une autre clé d’interprétation de la réalité. A travers son témoignage, l’auteure a cherché à « desorcelliser » la voyance.
Même quand une personne a des « flashs », ces images restent toujours interprétables. Valérie Fauchet insiste sur le fait qu’il n’y a pas de vérité absolue, même sur le passé. Sa voyance est la possibilité « d’offrir un autre regard ». La façon de vivre l’évènement prédit est elle-aussi subjective. Par conséquent, attention à l’hubris : ne jamais prédire des choses de façon catégorique. Le doute cartésien doit être la règle, même dans ce domaine de l’intuition. La médiumnité reste un mystère et n’obéit à aucune loi.
Cet ouvrage souhaite offrir une vision moins matérialiste du monde dans lequel nous vivons.
Valérie Fauchet a parfois l’impression d’être à la fois sur terre et dans l’au-delà. C’est dur de vivre cette dualité, c’est comme le destin de mélusine, mi-femme mi-serpent, ce type de femmes dérange…
Notre monde continue de refuser la complexité.
J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteure, suite à la lecture de son témoignage. Je vous ferai part bientôt de nos échanges dans un prochain article...
Une voyante passe aux aveux, Editions Ipanema 2019, 233 pages, 17,90 €
 LIVRES PHILous
LIVRES PHILous
Lundi 1 Juillet 2019
Le Medef a annulé la semaine dernière l'invitation de Marion Maréchal à ses université d'été, pour participer à une table ronde intitulée "La grand peur des mal pensants, pourquoi les populistes sont populaires". Cette annulation de dernière minute, au-delà d'une dictature du politiquement correct, révèle surtout le déni de reconnaître la lente extinction de la classe moyenne française. Cette lente disparition est le terreau de la vague populiste. Christophe Guilluy décrit parfaitement bien ce phénomène sociétal dans No Society, la fin de la classe moyenne occidentale. Cette lente agonie est entretenue par le flou de sa définition, car il est compliqué de cadrer ce qu'est une moyenne...
A coup de chiffres cinglants et de propos hors du sable mouvant du politiquement correct, Christophe Guillluy décrit la détresse et la lente extinction de la classe moyenne occidentale.
Même s’il est aisé de manipuler les chiffres, l’auteur livre une réalité sans concession : entre 1980 et 2007, le salaire français moyen n’a progressé que de 0.82 % par an (au demeurant, pour les 0.01 % les mieux payés, il a explosé de + 340 %...).Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Et en 2017, il s’est produit un phénomène inédit aux États-Unis : l’espérance de vie des Américains a reculé, en raison de la drogue. Cet excès de drogue en dit long sur le malaise de notre civilisation... Cette extinction lente de la classe moyenne est entretenue par le flou de sa définition.
Le flou de la notion de classe moyenne
Qui constitue la classe moyenne aujourd’hui ? Le flou de la notion de la classe moyenne permet un brouillage de classe, « qui autorise opportunément la confusion entre les perdants et les gagnants ». Selon les définitions, la proportion de la classe moyenne varie entre 50 à 70% de la société. Ceux qui assurent ou plutôt maintiennent la survie de la classe moyenne en France sont les retraités et les fonctionnaires. Les autres ont tendance à glisser vers la classe populaire. Et de nouvelles classes supérieures urbanisées sont nées, celle qui bénéficient de la mondialisation.
Christophe Guilluy a raison de rappeler que l’appartenance à une classe sociale n’est pas qu’une question d’argent. Si l’on réduit les classes sociales au montant des revenus uniquement, on tue la classe moyenne sournoisement une deuxième fois. La disparition de la classe moyenne occidentale se mesure aussi par la perte d’un statut, celui de référent culturel. Et cette perte de référent culturel est un danger pour les sociétés occidentales.
En dehors des retraités et des fonctionnaires, on comprend que la classe moyenne n’existe quasiment plus, elle est aspirée par la classe populaire.
Pourquoi un tel snobisme envers les classes populaires ?
Plutôt que d’essayer de comprendre la lente déchéance des classes moyennes, l’opinion dominante préfère mépriser la classe populaire en les rejetant dans des caricatures faciles « les chtis buveurs de bière », la « working class ». Ces images d’Épinal sont rassurantes, puisqu’elles permettent d’éluder un diagnostic rationnel de notre société. Il y a un certain mépris de classe à travers les séries les Deschiens, les Guignols de l’info qui avaient trouvé un bouc-émissaire vedette : Johnny Hallyday. « La religion du politiquement correct apparaît comme une arme de classe très efficace contre l’ancienne classe moyenne ». Nous constatons une « citadellisation de la classe dominante », qui méprise la classe ouvrière, sa culture, son attachement à la famille et la religion.
La vague populiste n’est pas qu’un phénomène idéologique, mais est liée à des réformes économiques. La classe dominante préfère faire culpabiliser sa classe populaire, en la ridiculisant et en l’enfermant dans une caricature de « bête et méchant », plutôt que de reconnaître la réalité économique et sociale. Pourtant, l’immigration produit un dumping social sur cette classe populaire que la classe dominante préfère occulter. Les tensions sont avant tout économiques, avant d’être culturelles.
Pourtant, « La poursuite du processus historique de sortie de la classe moyenne fragilise un monde d’en haut de plus en plus fébrile. ». La société mondialisée traduit paradoxalement un repli du monde d’en haut sur ses bastions. L’historien Christopher Lasch avait déjà décrit (en 1979) comment la culture du narcissisme et de l’égoïsme allait conduire l’Amérique à sa ruine antisociale. Cette nouvelle bourgeoisie asociale cherche même à prendre le contrôle de l’intelligence, symptôme qui se retrouve dans la tendance transhumaniste, prête à tout pour rendre le cerveau humain plus performant.
Le problème est que la posture morale d’en haut ne convainc plus, n’est plus crédible. En témoigne d’après l’auteur, la chute de Canal +, qui « a porté au plus haut la culture dominante en surjouant la posture morale et l’ostracisation des classes populaires ».
La protection de la classe moyenne et populaire permettrait une politique plus écologique
Le refus du protectionnisme affaiblit indéniablement les classes populaires. Ce sont eux les perdants : la mondialisation les précarise. Mais il n’y a pas que sur les classes populaires où la mondialisation est destructrice, elle est également plus polluante que l’ancienne économie. Les fraises chinoises sont par exemple très compétitives, mais elles réclament vingt fois plus d’équivalent-pétrole que la fraise du Périgord. Ainsi, si notre société prenait davantage soin de ses agriculteurs, cela permettrait un meilleur respect de l’environnement. Le PIB, vieille mesure qu’il serait temps de réformer, est en partie responsable de cette économie vorace et destructrice. Le PIB est incomplet dans sa mesure, car il exclut les facteurs environnementaux , l’épuisement des ressources. Et surtout, le PIB ne tient pas compte de l’inégalité. Cette notion de répartition des richesses est pourtant essentielle. Certains économistes proposent d’élaborer un indicateur englobant la consommation, le loisir, la mortalité, l’inégalité et le coût environnemental.
N’oublions pas : « La survie de la société occidentale passe par la protection de ses classes populaires, son peuple ».
NO SOCIETY, La fin de la classe moyenne occidentale, Christophe Guilluy, Flammarion, 2018, 241 pages, 18 €
Même s’il est aisé de manipuler les chiffres, l’auteur livre une réalité sans concession : entre 1980 et 2007, le salaire français moyen n’a progressé que de 0.82 % par an (au demeurant, pour les 0.01 % les mieux payés, il a explosé de + 340 %...).Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Et en 2017, il s’est produit un phénomène inédit aux États-Unis : l’espérance de vie des Américains a reculé, en raison de la drogue. Cet excès de drogue en dit long sur le malaise de notre civilisation... Cette extinction lente de la classe moyenne est entretenue par le flou de sa définition.
Le flou de la notion de classe moyenne
Qui constitue la classe moyenne aujourd’hui ? Le flou de la notion de la classe moyenne permet un brouillage de classe, « qui autorise opportunément la confusion entre les perdants et les gagnants ». Selon les définitions, la proportion de la classe moyenne varie entre 50 à 70% de la société. Ceux qui assurent ou plutôt maintiennent la survie de la classe moyenne en France sont les retraités et les fonctionnaires. Les autres ont tendance à glisser vers la classe populaire. Et de nouvelles classes supérieures urbanisées sont nées, celle qui bénéficient de la mondialisation.
Christophe Guilluy a raison de rappeler que l’appartenance à une classe sociale n’est pas qu’une question d’argent. Si l’on réduit les classes sociales au montant des revenus uniquement, on tue la classe moyenne sournoisement une deuxième fois. La disparition de la classe moyenne occidentale se mesure aussi par la perte d’un statut, celui de référent culturel. Et cette perte de référent culturel est un danger pour les sociétés occidentales.
En dehors des retraités et des fonctionnaires, on comprend que la classe moyenne n’existe quasiment plus, elle est aspirée par la classe populaire.
Pourquoi un tel snobisme envers les classes populaires ?
Plutôt que d’essayer de comprendre la lente déchéance des classes moyennes, l’opinion dominante préfère mépriser la classe populaire en les rejetant dans des caricatures faciles « les chtis buveurs de bière », la « working class ». Ces images d’Épinal sont rassurantes, puisqu’elles permettent d’éluder un diagnostic rationnel de notre société. Il y a un certain mépris de classe à travers les séries les Deschiens, les Guignols de l’info qui avaient trouvé un bouc-émissaire vedette : Johnny Hallyday. « La religion du politiquement correct apparaît comme une arme de classe très efficace contre l’ancienne classe moyenne ». Nous constatons une « citadellisation de la classe dominante », qui méprise la classe ouvrière, sa culture, son attachement à la famille et la religion.
La vague populiste n’est pas qu’un phénomène idéologique, mais est liée à des réformes économiques. La classe dominante préfère faire culpabiliser sa classe populaire, en la ridiculisant et en l’enfermant dans une caricature de « bête et méchant », plutôt que de reconnaître la réalité économique et sociale. Pourtant, l’immigration produit un dumping social sur cette classe populaire que la classe dominante préfère occulter. Les tensions sont avant tout économiques, avant d’être culturelles.
Pourtant, « La poursuite du processus historique de sortie de la classe moyenne fragilise un monde d’en haut de plus en plus fébrile. ». La société mondialisée traduit paradoxalement un repli du monde d’en haut sur ses bastions. L’historien Christopher Lasch avait déjà décrit (en 1979) comment la culture du narcissisme et de l’égoïsme allait conduire l’Amérique à sa ruine antisociale. Cette nouvelle bourgeoisie asociale cherche même à prendre le contrôle de l’intelligence, symptôme qui se retrouve dans la tendance transhumaniste, prête à tout pour rendre le cerveau humain plus performant.
Le problème est que la posture morale d’en haut ne convainc plus, n’est plus crédible. En témoigne d’après l’auteur, la chute de Canal +, qui « a porté au plus haut la culture dominante en surjouant la posture morale et l’ostracisation des classes populaires ».
La protection de la classe moyenne et populaire permettrait une politique plus écologique
Le refus du protectionnisme affaiblit indéniablement les classes populaires. Ce sont eux les perdants : la mondialisation les précarise. Mais il n’y a pas que sur les classes populaires où la mondialisation est destructrice, elle est également plus polluante que l’ancienne économie. Les fraises chinoises sont par exemple très compétitives, mais elles réclament vingt fois plus d’équivalent-pétrole que la fraise du Périgord. Ainsi, si notre société prenait davantage soin de ses agriculteurs, cela permettrait un meilleur respect de l’environnement. Le PIB, vieille mesure qu’il serait temps de réformer, est en partie responsable de cette économie vorace et destructrice. Le PIB est incomplet dans sa mesure, car il exclut les facteurs environnementaux , l’épuisement des ressources. Et surtout, le PIB ne tient pas compte de l’inégalité. Cette notion de répartition des richesses est pourtant essentielle. Certains économistes proposent d’élaborer un indicateur englobant la consommation, le loisir, la mortalité, l’inégalité et le coût environnemental.
N’oublions pas : « La survie de la société occidentale passe par la protection de ses classes populaires, son peuple ».
NO SOCIETY, La fin de la classe moyenne occidentale, Christophe Guilluy, Flammarion, 2018, 241 pages, 18 €
 LIVRES PHILous
LIVRES PHILous
Dimanche 28 Avril 2019
Le bien-être est semble-t-il devenu une obsession dans nos sociétés occidentales, voire une injonction. Faut-il s’en inquiéter ou au contraire se réjouir de cette nouvelle norme qui cherche à faire augmenter notre taux de sérotonine ? Même les entreprises s’intéressent au bien-être de leurs salariés, en mettant en œuvre des mesures séduisantes de QVT (Qualité de vie au Travail).
Doit-on l’interpréter comme un changement de paradigme ? Ou au contraire comme un nouveau subterfuge du capitalisme, pour que les salariés se sentent aussi bien au travail que chez eux et qu’ils travaillent, au bout du compte, un peu plus…
Dans la comédie (in)humaine, livre co-écrit par Julia de Funès et Nicolas Bouzou, cette idéalisation du bien-être permettrait selon eux de masquer une défaillance du management. Un babyfoot ne peut pas se substituer à un management bienveillant. Le bien-être serait plutôt utilisé comme un gadget ou encore une rustine par les entreprises.
Dans l’obsession du bien-être, Benoît Heilbrunn oriente ses propos dans le même sens : « Cette doudouisation du monde nous rappelle que le principal mécanisme sur lequel le capitalisme s’appuie est l’infantilisation des adultes. »
Dès lors derrière cette « doudouisation » du monde, se cacherait le vilain capitalisme vorace, prêt à tout pour générer toujours plus de croissance. Même prêt à « transformer l’émotion en marchandise »… Le bien-être serait-il alors une nouvelle marchandise pour nous asservir davantage ?
On peut souscrire à cette interprétation. Néanmoins, elle n’est pas la seule. On peut discerner également dans ce phénomène du bien-être, une féminisation du monde du travail qui crée une rupture avec la décoration froide des bureaux trop carrés et monotones. Ce qui peut expliquer des environnements plus cocooning, plus rose, plus doux. C’était d’ailleurs la stratégie d’Apple au départ, de parier sur un design plus rond contre Microsoft, plus rigide et froid.
Nos auteurs décèlent dans cette quête perpétuelle du bien-être l’échec cuisant de l’idée du bonheur. Comme si nos sociétés avaient renoncé à l’idée du bonheur. Même si le bien-être n’est pas synonyme de bonheur, pourquoi serait-il l’opposé de ce dernier ?
Le bien-être n’est certes pas le bonheur, mais il y contribue...
Même si le bonheur est selon J. de Funès et N. Bouzou « indéfinissable », « instable » « dépendant », le bien-être n’est pas du « bonheurisme ». Le bien-être est une notion scientifique, contrairement au bonheur qui est une question philosophique. Une bonne gestion du stress, un « flow » serein, des émotions positives, génèrent du bien-être. Nous sommes alors bien dans notre corps. Pour autant, ce n’est pas le bonheur, mais un corps heureux ne prédispose-t-il pas à un meilleur bonheur ? La QVT permet de nous faciliter le quotidien, mais effectivement si notre travail est mortellement ennuyeux, cela n’y changera rien. Et si nous sommes harcelés par un manager, les effets de la QVT sont complètement annihilés. Le stress, véritable fléau des temps modernes, est le terreau idéal pour le business du bien-être. Selon l'OMS, le stress toucherait 53% des salariés et serait à l'origine de plus de 50% des arrêts de travail… L'économie du bien-être permet dès lors de mieux gérer son stress, mais n'agit pas sur les causes qui génèrent ce stress. Et c'est en cela que les auteurs de la comédie (in)humaine ont raison, les entreprises préfèrent agir sur les conséquences d'un management trop robotisé, plutôt que sur les causes de ce stress.
N'oublions pas comme le soulignent N. Bouzou et J. de Funès que la joie est la conséquence d’un travail accompli. C’est un travail passionnant qui peut créer les conditions idéales de bien-être, plutôt que des gadgets superficiels. « La joie est le signe dit Bergson que la vie a réussi ». Ou comme le pensait Spinoza, la joie nous révèle que nous sommes dans la bonne voie, que nous nous perfectionnons. L’entreprise doit favoriser l’accomplissement. Et pourquoi pas la passion ?
Autre signal faible dans les entreprises, cette fois-ci plus inquiétant : la glorification de travail collaboratif et de l’intelligence collective. Nous sommes tous convaincus que l’intelligence collective nous permet d’aller plus loin. Mais encore faudrait-il définir cette intelligence collective… Quand nous lisons un article ou un livre, nous sommes déjà dans l’intelligence collective, puisque l’on se confronte aux multiples expériences et pensées d’un auteur. Il ne faudrait pas que cette apologie du travail collaboratif masque une dictature larvée, celle de ne jamais permettre le débat...
L’obsession du travail collaboratif peut cacher une envie de broyer les individualités...
Les entreprises raffolent en ce moment de brainstormings, d’ateliers collaboratifs. Or le brainstorming évite la confrontation. Il faut dire « oui et » et pas « non mais » pour rebondir sur les propos d’un autre participant. Or la confrontation est nécessaire et n’est pas synonyme de conflit. « Les idées vraies sont celles qui dépassent les contradictions ». Les effets indirects de ces séances de brainstorming est de diluer l’individu, et surtout de nier l’expertise. Le capitalisme est fondé sur la compétition. Comment, alors cette compétition peut-elle se trouver subrepticement avalée par un travail collaboratif ? Cette idéalisation du « tout collectif » déstabilise inconsciemment l’individu et stoppe ses revendications. C’est dans cet excès d’injonction de travail collaboratif, que l’on peut deviner les débuts d’une aliénation, comme si on dévalorisait les individus qui pensaient par eux-mêmes.
Et effectivement, le bonheur n’est possible que si nous sommes libres. Le bien-être sans liberté c’est une prison dorée, qui nous endort et nous éloigne de notre être profond.
Cependant, le bien-être a au moins une vertu : celui de reconnaître l'importance du corps, ce qui crée une rupture avec la conception cartésienne qui oppose le corps à l'esprit. "Un esprit sain dans un corps sain", comme l'écrivait dans ses essais Montaigne. Il ne faut pas dédaigner son corps, en cela l'industrie du bien-être est une chance.
Méfions-nous néanmoins des mesures permanentes de satisfaction et de bien-être… La notation est une forme de dictature larvée.
Un bonheur ne se mesure pas.
La comédie (in)humaine, Julia de Funès et Nicolas Bouzou, 2018, Editions de l’Observatoire.
L’obsession du bien-être, Benoît Heilbrunn, 2019, Robert Laffont.
Dans l’obsession du bien-être, Benoît Heilbrunn oriente ses propos dans le même sens : « Cette doudouisation du monde nous rappelle que le principal mécanisme sur lequel le capitalisme s’appuie est l’infantilisation des adultes. »
Dès lors derrière cette « doudouisation » du monde, se cacherait le vilain capitalisme vorace, prêt à tout pour générer toujours plus de croissance. Même prêt à « transformer l’émotion en marchandise »… Le bien-être serait-il alors une nouvelle marchandise pour nous asservir davantage ?
On peut souscrire à cette interprétation. Néanmoins, elle n’est pas la seule. On peut discerner également dans ce phénomène du bien-être, une féminisation du monde du travail qui crée une rupture avec la décoration froide des bureaux trop carrés et monotones. Ce qui peut expliquer des environnements plus cocooning, plus rose, plus doux. C’était d’ailleurs la stratégie d’Apple au départ, de parier sur un design plus rond contre Microsoft, plus rigide et froid.
Nos auteurs décèlent dans cette quête perpétuelle du bien-être l’échec cuisant de l’idée du bonheur. Comme si nos sociétés avaient renoncé à l’idée du bonheur. Même si le bien-être n’est pas synonyme de bonheur, pourquoi serait-il l’opposé de ce dernier ?
Le bien-être n’est certes pas le bonheur, mais il y contribue...
Même si le bonheur est selon J. de Funès et N. Bouzou « indéfinissable », « instable » « dépendant », le bien-être n’est pas du « bonheurisme ». Le bien-être est une notion scientifique, contrairement au bonheur qui est une question philosophique. Une bonne gestion du stress, un « flow » serein, des émotions positives, génèrent du bien-être. Nous sommes alors bien dans notre corps. Pour autant, ce n’est pas le bonheur, mais un corps heureux ne prédispose-t-il pas à un meilleur bonheur ? La QVT permet de nous faciliter le quotidien, mais effectivement si notre travail est mortellement ennuyeux, cela n’y changera rien. Et si nous sommes harcelés par un manager, les effets de la QVT sont complètement annihilés. Le stress, véritable fléau des temps modernes, est le terreau idéal pour le business du bien-être. Selon l'OMS, le stress toucherait 53% des salariés et serait à l'origine de plus de 50% des arrêts de travail… L'économie du bien-être permet dès lors de mieux gérer son stress, mais n'agit pas sur les causes qui génèrent ce stress. Et c'est en cela que les auteurs de la comédie (in)humaine ont raison, les entreprises préfèrent agir sur les conséquences d'un management trop robotisé, plutôt que sur les causes de ce stress.
N'oublions pas comme le soulignent N. Bouzou et J. de Funès que la joie est la conséquence d’un travail accompli. C’est un travail passionnant qui peut créer les conditions idéales de bien-être, plutôt que des gadgets superficiels. « La joie est le signe dit Bergson que la vie a réussi ». Ou comme le pensait Spinoza, la joie nous révèle que nous sommes dans la bonne voie, que nous nous perfectionnons. L’entreprise doit favoriser l’accomplissement. Et pourquoi pas la passion ?
Autre signal faible dans les entreprises, cette fois-ci plus inquiétant : la glorification de travail collaboratif et de l’intelligence collective. Nous sommes tous convaincus que l’intelligence collective nous permet d’aller plus loin. Mais encore faudrait-il définir cette intelligence collective… Quand nous lisons un article ou un livre, nous sommes déjà dans l’intelligence collective, puisque l’on se confronte aux multiples expériences et pensées d’un auteur. Il ne faudrait pas que cette apologie du travail collaboratif masque une dictature larvée, celle de ne jamais permettre le débat...
L’obsession du travail collaboratif peut cacher une envie de broyer les individualités...
Les entreprises raffolent en ce moment de brainstormings, d’ateliers collaboratifs. Or le brainstorming évite la confrontation. Il faut dire « oui et » et pas « non mais » pour rebondir sur les propos d’un autre participant. Or la confrontation est nécessaire et n’est pas synonyme de conflit. « Les idées vraies sont celles qui dépassent les contradictions ». Les effets indirects de ces séances de brainstorming est de diluer l’individu, et surtout de nier l’expertise. Le capitalisme est fondé sur la compétition. Comment, alors cette compétition peut-elle se trouver subrepticement avalée par un travail collaboratif ? Cette idéalisation du « tout collectif » déstabilise inconsciemment l’individu et stoppe ses revendications. C’est dans cet excès d’injonction de travail collaboratif, que l’on peut deviner les débuts d’une aliénation, comme si on dévalorisait les individus qui pensaient par eux-mêmes.
Et effectivement, le bonheur n’est possible que si nous sommes libres. Le bien-être sans liberté c’est une prison dorée, qui nous endort et nous éloigne de notre être profond.
Cependant, le bien-être a au moins une vertu : celui de reconnaître l'importance du corps, ce qui crée une rupture avec la conception cartésienne qui oppose le corps à l'esprit. "Un esprit sain dans un corps sain", comme l'écrivait dans ses essais Montaigne. Il ne faut pas dédaigner son corps, en cela l'industrie du bien-être est une chance.
Méfions-nous néanmoins des mesures permanentes de satisfaction et de bien-être… La notation est une forme de dictature larvée.
Un bonheur ne se mesure pas.
La comédie (in)humaine, Julia de Funès et Nicolas Bouzou, 2018, Editions de l’Observatoire.
L’obsession du bien-être, Benoît Heilbrunn, 2019, Robert Laffont.
Dernières notes
"socrate au pays de la pub"
Adam Smith
Adèle Van Reeth
Alexandre Lacroix
amour
andré comte-sponville
andré comte-sponville luc ferr
Anne-Laure Buffet
apple
Art
Arthur Rimbaud
Balthasar Thomass
bayrou
beigbeder
Benoït Heilbrunn
bergson créativité
bien-être
bobo
bonheur
bridget jones
Café-philo
catherine kintzler
cerveau
chatgpt cerveau droit gauche
christian magnan
Freud
marx
Nietzsche
philosophie
schopenhauer
Rubriques
Profil
Marjorie Rafécas

Passionnée de philosophie et des sciences humaines, je publie régulièrement des articles sur mon blog Philing Good, l'anti-burnout des idées (http://www.wmaker.net/philobalade), ainsi que sur La Cause Littéraire (https://www.lacauselitteraire.fr). Je suis également l'auteur de La revanche du cerveau droit co-écrit avec Ferial Furon (Editions du Dauphin, 2022), ainsi que d'un ouvrage très décalé Descartes n'était pas Vierge (2011), qui décrit les philosophes par leur signe astrologique.
Archives
Infos XML